FABBRI Fabio, Le origini della guerra civile. L’Italia dalla Grande Guerra al fascismo, 1918-1921 (par Marco Pluviano et Irene Guerrini)
Reflets et influences de l’expérience de guerre dans la violence fasciste en Italie de 1919 à 1922 dans la récente production historiographique
(Recension par Irene Guerrini et Marco Pluviano)
Au cours de ces dernières années, deux livres ont été publiés en Italie au sujet de la violence fasciste qui accompagna les années précédant le coup d’État connu comme « la marche sur Rome » : l’étude de l’historien italien Fabio Fabbri, Le origini della guerra civile. L’Italia dalla Grande Guerra al fascismo, 1918-1921, Torino, UTET, 2009, et le travail de l’historien allemand Sven Reichardt, traduit sous le titre Camice nere, camice brune. Milizie fasciste in Italia e in Germania, Bologna, Il Mulino, 2009 (Faschistische Kampfbünde. Gewalt und Gemeinschaft im italienischen Squadrismus und in der deutschen SA, Köln, Bohlau Verlag, 2002).
Il doit être clair qu’il s’agit de deux études différentes entre elles. La première affronte le sujet du développement de la violence du « squadrismo » (l’ensemble des bandes armées fascistes) dans un cadre qui, pour l’auteur, se configure comme une véritable « guerre civile » menée par les fascistes contre les socialistes, les syndicalistes et, à partir de janvier 1921, les communistes, avec le plein soutien des catholiques, des libéraux et du patronat agraire et industriel, de l’armée et de la plupart des organes politiques et administratifs de l’État démocratique.
Le second auteur, par contre, se concentre principalement sur l’analyse des caractéristiques sociales, professionnelles, culturelles des membres des milices fascistes en Italie et en Allemagne, en développant un examen de type comparatif. En outre, il consacre beaucoup d’attention à l’examen des dynamiques de groupe, des mécanismes identitaires, et à l’étude du développement de l’esprit de corps, en mettant ceci en relation avec les origines sociales des individus et avec leur situation professionnelle. En ce qui concerne l’Allemagne, Reichardt détermine dans la « communauté militante » un élément substitutif de la famille pour les jeunes S.A. (Sturmabteilung). Ces derniers, étant victimes du chômage grandissant, laissaient leur famille ou en étaient souvent expulsés, et ils n’étaient pas aptes à s’en créer une propre.
En considération de ceci, et d’autres éléments de grand intérêt, nous voulons analyser ici une des composantes de l’expérience du « squadrismo » italien qui émerge avec vigueur de l’examen des deux ouvrages : l’importance fondamentale de l’expérience de guerre.
On sait bien que la Grande Guerre constitua un des principaux éléments constitutifs pour toutes les forces politiques d’extrême droite dans l’immédiat après-guerre, soit dans les pays dans lesquels elles conquirent ensuite le pouvoir, soit dans ceux dans lesquels l’État démocratique les maintint aux marges, après les avoir éventuellement utilisées dans la lutte anti-prolétarienne.
Ce que montrent les deux livres, c’est que, parlant de l’expérience de guerre, on ne doit pas se limiter à rechercher en elle « l’ADN » du fascisme, mais qu’il faut montrer qu’elle en a accompagné le développement et la croissance d’organisation, en représentant tout d’abord un des facteurs fondamentaux pour la survie et par la suite pour le triomphe du mouvement de Mussolini.
Le rappel de la Grande Guerre ne se limitait donc pas à l’adoption de termes du langage des soldats, ou à la réitération de l’expérience héroïque par antonomase afin de galvaniser les jeunes qui n’avaient connu la guerre que par les journaux, ou l’avaient connue par les récits des frères aînés, ou l’avaient idéalisée à travers la mythisation de la mémoire de quelque conjoint mort au combat. La guerre donna en effet au fascisme les atouts qui permirent à un mouvement ultra-minoritaire de vaincre assez rapidement une organisation socialiste et syndicale très forte, enracinée dans tout le pays, douée d’une expérience d’au moins trente ans dans la mobilisation, et qui ne reculait pas devant l’affrontement physique.
Tout de suite le fascisme assimila les modalités très modernes, au moins pour l’Italie, d’organisation des hommes que la guerre avait développée surtout dans la dernière année et demie. Ce n’est pas un hasard si le corps militaire de référence, soit du point de vue de l’autoreprésentation des « squadristi » (membres des bandes armées fascistes), soit en ce qui concernait l’organisation pratique des « Squadre d’azione » (équipes d’action fascistes), fut celui des « Arditi » (les fantassins spécialement entraînés pour remplir des missions dangereuses), qui avait constitué un des éléments de majeure nouveauté dans l’expérience de guerre italienne. Ainsi, comme les Arditi avaient privilégié l’action démonstrative par surprise, menée par de petits groupes fortement autonomes, commandés par des officiers subalternes, les fascistes basèrent leur stratégie de pénétration et conquête des citadelles rouges – surtout dans les campagnes et les petites villes – sur les équipes d’action. Ces équipes étaient guidées par des jeunes, souvent ex-officiers ou sous-officiers (fréquemment ex-Arditi) ; elles évoluaient avec grande rapidité sur des véhicules fournis par des propriétaires terriens et des industriels ou, souvent, « laissés sans surveillance » par l’armée ; elles visaient toujours à obtenir des résultats symboliques de nature militaire comme, par exemple, la capture des enseignes socialistes, l’élimination du drapeau rouge des sièges communaux administrés par le parti socialiste, l’humiliation publique des dirigeants adverses, la destruction des « centres de commandement » ennemis (Chambre du travail, siège de parti, siège des coopératives). Les expéditions, réalisées souvent la nuit comme les actions des Arditi, avaient la caractéristique d’une incursion plus ou moins longue en territoire ennemi, conduite avec l’objectif de frapper et désarticuler l’organisation adverse, plutôt que de maintenir le contrôle du territoire (à cela on arrivera plus tard, à partir de 1921).
Le lien très étroit des techniques de la violence fasciste et de celles de la guerre fut orgueilleusement revendiqué même par les « gerarchi » (chefs politiques fascistes) locaux et les sommets nationaux, et il servit sûrement pour confirmer, dans la masse des sympathisants, l’identification entre la défense de la patrie menée par les Arditi et celle de la bourgeoisie (soit comme classe sociale, soit comme dépositaire des valeurs de la civilisation face à l’invasion de la marée subversive), défense menée les armes à la main comme le voulait la propagande des disciples de Mussolini.
L’appropriation de l’héritage de guerre ne se limita pas à une aussi essentielle utilisation des tactiques militaires. Un autre instrument décisif que les fascistes réussirent à obtenir et à maintenir solidement fut la participation à leurs entreprises de militaires en service, surtout des officiers. Pour comprendre ceci, il faut considérer que la démobilisation de l’armée italienne fut lente, pour des raisons d’ordre militaire (tensions avec la Yougoslavie voisine, expéditions à l’étranger, conflit de Fiume à partir de l’automne 1919), ou d’ordre politique (utilisation continue de l’armée en service d’ordre public contre des ouvriers et des paysans).
Il y eut encore une autre raison qui contribua à maintenir en service une force disproportionné par rapport aux nécessités : la difficulté de replacer dans le monde du travail les militaires libérés, particulièrement les officiers. Le marché du travail n’offrait pas, en effet, de places suffisantes à la hauteur des aspirations mûries par des hommes qui s’étaient habitués à l’exercice du commandement sans avoir, surtout ceux des dernières levées, les nécessaires compétences culturelles et professionnelles ; à partir de 1917, en effet, pouvaient participer aux cours pour devenir officier de complément les jeunes qui avaient seulement fréquenté au moins deux ans d’institut supérieur. En conséquence de ceci, les officiers restèrent en service en proportion supérieure à celle des soldats, en obtenant aussi l’autorisation de fournir un service très léger dans les villes mêmes où ils reprenaient leurs études interrompues ou avaient à défendre les intérêts de leur famille. Il était donc fréquent de voir rôder dans les villes des groupes d’officiers en uniforme, à peu près libres de service, incertains sur les perspectives que leur réservait l’avenir, mais sûrs que les vigoureux mouvements sociaux qui bouleversaient villes et campagnes représentaient une menace pour leur position sociale. Sur ces jeunes, habitués à l’exercice de la violence et du commandement, la propagande fasciste eut prise facile. Ceci peut bien expliquer la raison de leur participation aux rassemblements de l’extrême droite et aux violences locales contre les manifestations de la gauche et contre les sièges socialistes et syndicaux, dénoncée fréquemment par les représentants de gauche mais aussi enregistrée avec complaisance par les fascistes et leurs soutiens dans l’administration de l’État. En résumé, ces fainéants de luxe constituèrent, surtout dans la période de formation des Équipes d’action, une masse précieuse de manœuvre, une sorte de « garde blanche » de chez nous.
Maintenant nous venons à l’analyse du dernier héritage de l’expérience de guerre, qui explique entre autre aussi le précédent : le soutien que les hiérarchies nationales, et encore plus locales, de l’armée garantirent aux bandes armées fascistes. Les commandements fermèrent les deux yeux face à la participation d’officiers en service aux manifestations fascistes, en violation ouverte de l’apolitisme qui, depuis toujours, constituait une des obligations des militaires italiens. Lorsque ces violations devinrent excessives, ils soutinrent qu’il ne s’agissait pas de manifestations politiques mais d’initiatives patriotiques et que même les violences constituaient simplement des actes de réaction contre les détracteurs de la patrie et de l’armée victorieuse.
Furent rarement inquiétés les officiers qui, commandés en service d’ordre public, avaient participé avec leurs subordonnés aux violences fascistes contre des hommes, sièges et représentants institutionnels de la gauche, au lieu de les protéger. Enfin, les commandements laissèrent souvent à disposition des Équipes d’action armes (même des mitrailleuses et des grenades), camions et parfois automitrailleuses, qui leur permettaient d’obtenir une supériorité inéluctable dans les mouvements des hommes et la vitesse de déplacement.
Pour conclure, les deux études montrent que l’expérience de guerre constitua vraiment l’axe du développement de la violence fasciste. Ceci, pas seulement du point de vue de la rhétorique patriotique et de l’auto-représentation comme défenseurs du « peuple des tranchées » contre les profiteurs de guerre et les embusqués, mais pour la création des dynamiques de groupe qui permirent la cohésion interne en milieux fortement hostiles.
Les volumes de Fabbri et de Reichardt montrent que la gauche italienne n’apprit pas la leçon terrible de modernité que la Grande Guerre laissa en héritage en ce qui concerne l’organisation des masses et leur action, avec l’exception partielle de groupes minoritaires tels les « Arditi del popolo » et certains secteurs du naissant mouvement communiste.
Ironie du sort, les socialistes, l’unique organisation de masse qui depuis toujours avait dénoncé les dangers immenses de la militarisation de la société, et qui s’était affrontée à elle dans les usines et dans la société pendant le conflit, n’avaient pas compris que ces techniques de mobilisation et de gestion de la violence auraient de plus en plus trouvé inévitablement application dans la lutte politique, surtout si celle-ci s’était radicalisée. Les socialistes restèrent convaincus que le conflit social aurait continué à se dérouler avec les mêmes dynamiques et les modalités d’avant guerre, et que la bourgeoisie aurait à la limite choisi la « dictature militaire » et n’aurait pas « adjugé » une guerre civile de basse intensité à une milice de parti qui aurait appliqué la leçon de la Grande Guerre sans aucun frein et sans devoir se plier à n’importe quel contrôle de la part des organes de l’État, même a posteriori.
Enfin, le Parti socialiste ne comprit pas l’autre leçon fondamentale qui venait de l’expérience européenne de la dernière année de guerre et des premiers mois de paix au sujet de la grande capacité de réaction des classes dominantes. Au lieu de décider rapidement dans l’alternative entre révolution et collaboration réformiste, pour ensuite agir en conséquence, il continua à utiliser slogans et programmes maximalistes sans avoir ni l’intention ni le courage d’imiter l’expérience bolchevique. De cette manière, il donna aux forces réactionnaires le temps de s’organiser, d’acquérir l’appui de l’oligarchie politique et économique et d’exercer son hégémonie sur la petite bourgeoisie, même dans ces secteurs qui avaient regardé avec faveur les socialistes dans les mois suivant immédiatement l’armistice.

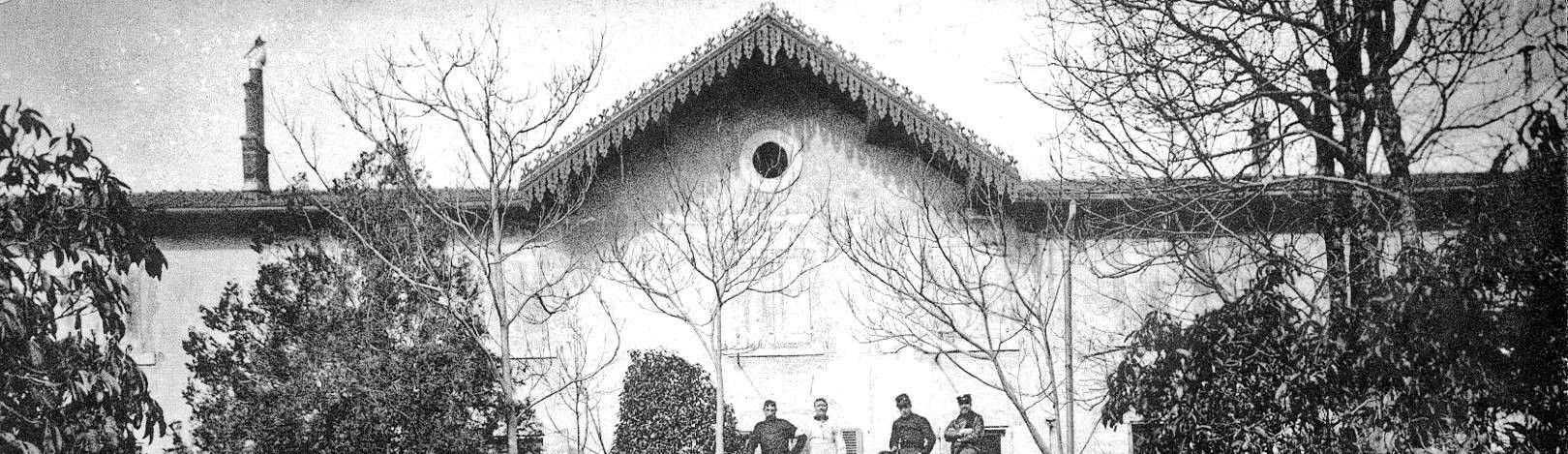
Les commentaires