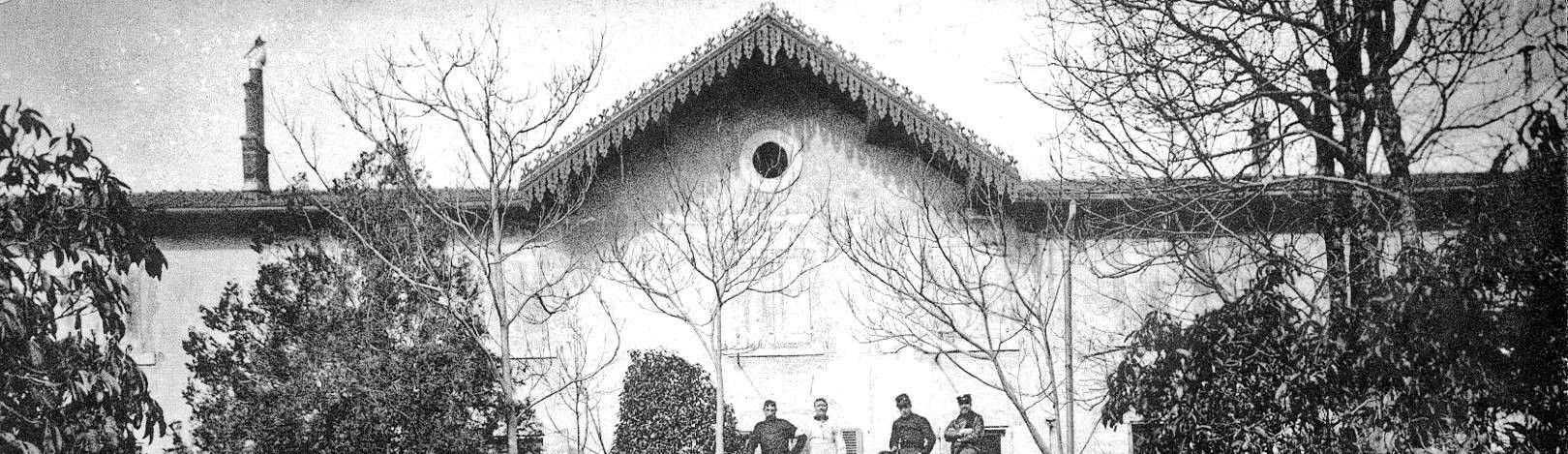Pour une première lettre…
Nous avons le plaisir de vous présenter la lettre n°1 du CDH 14-18.
Nous espérons pouvoir mettre à votre disposition de nombreux exemplaires au fil des années. Si vous avez envie de l’alimenter nous en serons très heureux, pour ce faire il suffit de nous contacter en nous adressant un courriel : NOUS ECRIRE .
Bonne lecture
les documents présents aux archives municipales de Valence
Dans la série des outils mis à la disposition des chercheurs, Julien Mathieu a établi 4 documents indispensables concernant:
Le recrutement militaire, 1793-1970 : Archives municipales Valence 1H_Recrutement,
L’administration militaire, 1768-1964 : Archives municipales Valence 2H_Administration militaire,
La garde nationale et les sapeurs pompiers, 1790-1967 : Archives municipales Valence 3H_Garde nationale-Pompiers,
Les mesures exceptionnelles et faits de guerre, An II-1972 : Archives municipales Valence 4H_Faits de guerre.
Ils sont consultables aux archives et surtout devraient nous permettre de rapidement faire les recherches autour de la guerre de 1914-1918.
Guide de recherche des archives municipales de Valence
Nous remercions Julien Mathieu, responsable des archives municipales de Valence de mettre à notre disposition un outil indispensable pour les historiens amateurs et professionnels qui est le guide de recherche des archives municpales de Valence portant sur la guerre de 1914-1918.
Vous pouvez le télécharger ICI et bien entendu en faire bon usage.
Les objectifs du Comité Départemental d’Histoire de la guerre de 14 18 dans la Drôme
Nous avons le plaisir pour ce premier article de vous inviter à consulter notre programme d’actions.
Nous espérons que vous y serez sensibles et que vous nous rejoindrez dans ce beau projet mariant histoire, humanité, connaissances et donc avenir.
Programme_d_action_du_comite_d_histoire_de_la_guerre_14-18_dans_la_Drome
Pour le comité
Delon, Louis (1894-1964)
Fils de gantier, né à Valence (Drôme) le 16 juillet 1894, il devient lui-même gantier à Millau (Aveyron). Il est mobilisé au 72e RI, puis il passe dans les régiments d’infanterie coloniale, le 42e en décembre 1915, le 6e en juillet 1918. Il combat dans l’armée d’Orient et il est victime du paludisme. Pour le « soigner », rien ne vaut le froid et on l’envoie à Arkhangelsk avec le 21e bataillon de marche, peu avant l’armistice du 11 novembre. Motif officiel : empêcher que ce port devienne une base pour les sous-marins allemands. Les soldats s’aperçoivent bien vite qu’il s’agit de combattre les bolcheviks. Le seul témoignage qu’ait laissé Louis Delon concerne le séjour à Arkhangelsk et particulièrement la mutinerie de mars 1919. L’épisode est exposé par Patrick Facon, d’après les documents d’archives, notamment 7N 816 et 817 du SHAT, dans son article de 1977 de la Revue d’histoire moderne et contemporaine (p. 455-474). Louis Delon a recopié sur un cahier conservé par sa famille une série de témoignages favorables aux mutins : lettres de réclamation contre le manque de nourriture et de couvertures, contre les brimades de certains officiers, etc. Surtout, l’argument central est celui-ci : « Les journaux français qui nous parviennent nous rapportent les paroles prononcées au parlement par le ministre de la Guerre : « Depuis le 11 novembre 1918 le bruit du canon a cessé pour tous les Français. » Ici, bien après cette date, mille coups de canon ont été tirés par l’ennemi en vingt-quatre heures ! Sommes-nous Français ? » Traités de lâches, accusés de salir le drapeau, les mutins répondent qu’ils se sont battus pendant quatre ans sur tous les fronts contre les ennemis, mais que la France n’est pas en guerre contre la Russie. Enfermés dans une baraque, on leur envoie un provocateur (« ce n’était ni plus ni moins qu’un fumiste envoyé ici par les officiers ») qui se présente comme ayant « des idées complètement révolutionnaires », à quoi les hommes répondent qu’il n’en est pas de même pour eux, qu’ils se moquent un peu de la politique et qu’ils réclament seulement leurs droits.
En conseil de guerre pour « refus d’obéissance sur un territoire en état de guerre », le commissaire du gouvernement renonce finalement à soutenir l’accusation. Du sous-lieutenant Rivaud, défenseur, Patrick Facon nous apprend qu’il était avocat à la cour d’appel de Paris. Louis Delon a retranscrit un résumé de son habile plaidoirie : « Sommes-nous en guerre avec la Russie ? […] Après la signature de l’armistice avec les Allemands, nos soldats ne pouvaient-ils pas se croire en droit de refuser de marcher contre les bolcheviks ? L’article 227 du code de justice militaire punit de la peine de mort tout commandant d’unité qui continuerait, après la signature d’un armistice, à donner des ordres pour continuer les hostilités. Ce ne sont pas ces soldats qui sont assis au banc des accusés qui méritent d’être punis mais bien celui ou ceux qui sont la cause que les soldats alliés continuent à combattre en Russie. » Le verdict rapporté par Patrick Facon comme par Louis Delon : deux mois de prison avec sursis. Il n’empêche que les mutins, au lieu de rentrer en France, sont envoyés en bataillon disciplinaire au Maroc. Louis Delon finit par retrouver Millau où il se marie en juin 1921, reprenant son métier de gantier.
RC
CENDRARS Blaise, Faire un prisonnier (par Yohann Chanoir)
CENDRARS, Blaise, Faire un prisonnier, Folio-Plus Classiques, 2012, 150 p. 4,2 €, n°235. Dossier présenté par Marianne Chomienne.
Dans une collection destinée aux enseignants de lettres, ce numéro est consacré à un texte de Blaise Cendrars, engagé dans la Légion Etrangère lors de la Grande Guerre. La lecture est articulée autour de trois parties distinctes.
D’abord, le texte de l’écrivain. Il s’agit ici de la relation par Cendrars, à la première personne, du coup de main éponyme effectué par sa section en Somme, afin de faire un prisonnier. Le lecteur trouvera dans ce texte percutant à la fois de l’humour, le langage fleuri des tranchées, le mépris du soldat envers les gradés, tant les officiers de l’arrière jugés ainsi aussi « fumiers » que les sous-officiers du front et de précieuses indications sur l’expérience combattante. Dans un espace particulier, entre terre et eau, Cendrars analyse sans fard sa « petite guerre » menée dans « la grande guerre », sa « petite guerre d’indiens dans la grande guerre usinière ». Patrouilles, rapines, débrouillardise, rigolades, rien n’évoque une « brutalisation », mais plutôt une adaptation permanente aux conditions du conflit, sans haine de l’autre, sans patriotisme exultant, et avec la résolution d’y échapper sain et sauf. Or, à la lumière des avancées historiographiques sur la concurrence conflictuelle des temporalités, dans la lignée des travaux de François Hartog, ce texte offre de nouvelles perspectives d’étude. Cendrars distingue clairement dans le temps nouveau que constitue la guerre un « temps ordinaire », permettant de la supporter, composé à la fois d’un « horizon d’attente » et d’une routine rassurante, éloignée de la dangerosité du conflit et de ses rythmes. A ce « temps ordinaire » s’oppose sous la plume de l’auteur de L’or, un « temps imposé », le temps du coup de main, le temps du combat, aléatoire, dangereux, risqué, bousculant les équilibres et l’inscription dans la temporalité précédente. Les travaux d’André Loez sur les refus de la guerre avaient déjà pressenti cette échelle de temporalités et leur conflictualité. Le texte de Cendrars apporte un nouvel élément au débat et conforte les intuitions de notre collègue.
La seconde partie de l’ouvrage est consacrée à une analyse picturale. Le choix retenu est assez surprenant, puisqu’il s’agit d’un tableau de 1911 ! Même si Artillerie de Roger de la Fresnaye est jugé « prémonitoire » (p.79), même si le dossier établit une communauté de destins entre Cendrars et de La Fresnaye (tous les deux ont participé à la guerre), cette vision téléologique est dérangeante et ne permet l’association entre l’image et le texte qu’en prenant bon nombre de précautions scientifiques, dont la quantité s’avère dirimante pour être, par exemple, matière à une exploitation pédagogique. Nos collègues du secondaire éviteront ces dispendieux efforts en choisissant un tableau contemporain des faits évoqués.
La dernière partie propose six thématiques pour une lecture plurielle, dont certaines (« scènes de guerre », « du bon usage de l’argot ») intéresseront notamment tous les amateurs de textes littéraires.
Bref, un petit ouvrage dont le coût modique et la force du texte de Cendrars peuvent inciter à l’achat et à lecture féconde, tant par plaisir littéraire que par intérêt scientifique.
Yohann Chanoir
BRECKINRIDGE Mary, Au secours des enfants du Soisonnais (par jean-François Jagielski)
Au secours des enfants du Soissonnais. Lettres américaines de Mary Breckinridge 1919-1921. Traduction et commentaires de Karen Polinger-Foster et Monique Judas-Urschel, Amiens, Encrage, 2012, 240 p.
Depuis une vingtaine d’années, un certain nombre de publications[1] se sont attachées à faire découvrir l’œuvre matérielle, sociale et morale du Comité américain des Régions dévastées (CARD) dans la région du Soissonnais. Cette œuvre, implantée dès 1917 sur le territoire de la commune de Blérancourt, était conjointement dirigée par Ann Murray Dike et Ann Morgan. Cette dernière, fille du dirigeant de l’une des plus importantes banques des Etats-Unis (J.P. Morgan), aurait pu mener la vie oisive à laquelle sa fortune personnelle l’autorisait. Mais cela aurait été assurément sans compter avec un caractère affirmé qui lui faisait déclarer qu’elle se refusait à jamais de n’être, selon ses termes, qu’une « riche idiote ». Aidée par un personnel presque entièrement féminin, elle mit en place une importante œuvre caritative qui visait à porter secours aux habitants de ce qu’on appelle alors les Régions dévastées (RD). En faisant notamment appel à la générosité des citoyens d’Outre Atlantique au moyen d’habiles campagnes de propagande[2] qui visaient à collecter des fonds et devaient aussi permettre d’« aider les gens à s’aider eux-mêmes, en leur apportant une aide matérielle et morale », selon les propres mots de Ann Murray Dike. D’abord cantonné à Blérancourt, le CARD essaime jusqu’à prendre en charge une vaste zone d’intervention dans le Soissonnais.
Si le rôle et l’œuvre de propagande du CARD sont bien connus grâce à l’important fonds d’archives conservés au musée franco-américain de Blérancourt, très peu de témoignages directs des membres de ce comité existent. Les deux dirigeantes du CARD nous ont d’ailleurs elles-mêmes laissé assez peu d’écrits personnels. La récente publication de 57 lettres inédites, retrouvées par Karen Polinger-Foster et écrites de la main de l’une des infirmières du CARD, Mary Breckenbridge[3], permet de compenser ce manque. La grande qualité de cette correspondance réside assurément dans la longueur, et donc la précision de chacune des lettres de l’infirmière adressées principalement à sa mère. On y découvre, dans le détail de la confidence, la vie quotidienne d’une américaine venue vivre dans le canton de Vic-sur-Aisne, un espace meurtri par la guerre, où, au fil des lettres, des hommes, des femmes et des enfants meurent encore et toujours à cause de la présence d’une multitude d’engins de guerre que la terre recrache quotidiennement. C’est aussi un monde d’absolu dénuement, tant matériel que moral. Les premiers habitants revenus dans leurs villages vivent pour la plupart dans les abris laissés par les soldats ou dans des baraquements de fortune. Ils parviennent difficilement à se mouvoir pour se procurer le strict nécessaire, tant les routes ont été détruites et les moyens de se déplacer sont devenus rares voire inexistants. Ils survivent tant bien que mal dans un univers de pur chaos où les habituelles infrastructures administratives, sociales, médicales et commerciales ont presque toutes disparu. Un monde où les tombes provisoires bordent les routes et où l’une des principales occupations du dimanche est d’aller les fleurir et les entretenir, afin qu’elles ne disparaissent pas. Une contrée où le spectacle est si effrayant que certains habitants sur le retour, désespérés, en viennent à se donner la mort[4].
Face à cet immense vide causé par la guerre en ces « pays aplatis » chers à l’écrivain Roland Dorgelès, la description des activités menées par les infirmières, les assistantes sociales, les conductrices de camions, de camionnettes, d’épiceries ambulantes voire de bibliobus sillonnant les contrées dévastées ne laisse pas d’étonner. Avec un souci de parfaite abnégation – la venue de caméramans ou de journalistes français et américains déconnectés des réalités ont plutôt tendance à agacer l’auteure de cette correspondance – l’ensemble du personnel féminin du CARD se démène chaque jour pour lutter contre les ravages causés par la malnutrition des enfants et les conditions d’hygiène déplorables dans lesquelles sont contraints de vivre les habitants. Fortement éprouvée à titre personnel par la perte d’un enfant, Mary Breckenridge va se spécialiser en France dans l’accompagnement de la toute petite enfance. Elle organise des « cliniques de surveillance des enfants, transportant des pèse-bébés (…) dans un camion, de village en village, à intervalles réguliers, pour peser et mesurer non seulement les enfants en dessous de 6 ans mais aussi les enfants plus âgés qui semble de santé délicate[5]. » Elle a ainsi en charge en 1919 la population infantile de 22 villages et ses journées n’en sont que plus harassantes. Mais cette correspondance laisse également place à l’évocation de l’immense travail mené par ses collègues : acheminement de graines, de poules, de lapins, de chèvres[6] qui seront revendus à prix coûtant (ou donnés) aux villageois les plus démunis, distribution de lait en poudre pour les enfants en bas âge, allocation de goûters aux enfants des écoles, de livres et de mobilier scolaire, achat et prêt de tracteurs ou d’engins agricoles modernes pour nettoyer et remettre en culture les riches terres du Soissonnais affectées par les combats[7], suivi social des familles les plus démunies, lutte contre la grippe espagnole ou la variole, mise en place et entretien d’hôpitaux dirigés par des femmes médecins (American Women’s Hospital), vente (ou distribution gratuite) de literies, de vêtements, de jouets, constitution de jardins d’enfants, diffusion de cours d’école ménagère. Les lettres de Mary Breckenridge témoignent ici d’un accompagnement hygiéniste et social exceptionnel pour l’époque, qu’on ne retrouvera généralisé que dans la France de l’après second conflit mondial. Cette correspondance permet également de mesurer comment fonctionnaient les services d’entre aide mutuelle entre les différentes œuvres, américaines, britanniques et celles de la Croix-Rouge au cœur même des RD. Leur efficacité est aussi réelle que directement mesurable : « Aucun de mes 70 bébés n’est mort cet été, précise une lettre en date du 31 août 1919[8]. »
Evoquons enfin cette très longue et très intéressante lettre du 8 juin 1919[9] où Mary Breckenbridge dresse un panorama de cette région qui, au sortir de la guerre, a beaucoup de mal à retrouver ses anciennes hiérarchies sociales, par ailleurs observées avec acuité par une étrangère qui maîtrise parfaitement la langue française. Tout d’abord, la paysannerie dont l’auteure, pleine d’admiration, compare l’abnégation au lendemain de la guerre à celle du soldat de Verdun[10]. Mais aussi une bourgeoisie faite de grands propriétaires terriens, ces Ferté, « riches et égocentriques ». Et enfin une noblesse, en complète perte de vitesse : avec ses « gentlemen-farmer » comme le comte Bertier de Sauvigny, maire de Coeuvre qui assure ses fonctions durant la presque totalité du conflit mais qui ne sera pas réélu aux élections municipales de 1919[11] ; la duchesse d’Albufera, propriétaire du château de Montgobert, issue de la noblesse d’empire mais qui a bien du mal à poursuivre ses œuvres de charité d’avant guerre pour avoir « été appauvrie par les pertes financière sur les mines de charbon » ; ou encore madame de Firino, propriétaire du château de Fontenoy mais qui ne l’occupe pas en ces temps difficiles (« pas le genre de personne qui abandonne son confort facilement et le luxe en aucun cas ») ; et enfin le vicomte de Reiset, propriétaire du château de Vic-sur-Aisne qui a été décoré pour des actes de résistance pendant l’occupation mais qui est une homme qui appartient plus au XVIIIe siècle (dont il collectionne les objets avec frénésie) qu’à son époque. En quelques pages, dans cette lettre adressée à une mère vivant à des milliers de kilomètres du Soissonnais, cette femme qui vit au quotidiennement au contact des gens de cette région, qui les visite, les côtoie, les aide, leur parle, les conseille, les soigne et discrètement les admire tous autant qu’ils sont, brosse un tableau étonnamment clairvoyant et vivant d’un territoire ravagé par la guerre où vivent – et parfois survivent – ces rescapés de la Grande Guerre.
[1] Evelyne Diebolt et Jean Pierre Laurant, Anne Morgan, une américaine en Soissonnais (1917-1952), A.M.S.A.M., 1990 ; Jean-Pierre Laurant, « Anne Morgan et le Comité américain des régions dévastées » in Collectif R. Cazals, E. Picard, D. Rolland (dir.), La Grande Guerre. Pratiques et expériences, Toulouse, Privat, 2005, pp. 375-382 ; Collectif, Des Américaines en Picardie. Au service de la France dévastée 1917-1924, Réunion des Musées nationaux, 2002.
[2] Certaines photographies faites pour ces campagnes de propagande ont été mises en ligne :
http://www.numerique.culture.fr/pub-fr/document.html?base=dcollection&id=FR-DC-SAP_012&from1=imgalea
[3]. Sur sa biographie et la suite de son engagement après son retour aux Etats-Unis, http://www.faqs.org/health/bios/50/Mary-Breckinridge.html
[4] Lettre du 23 mars 1919, p 41.
[5] Lettre du 1er mai 1919, p. 61
[6] Elles occupent une place importante dans cette correspondance car elles permettent de rassasier les nourrissons quand le lait maternel s’avère insuffisant.
[7] « Notre canton de Coucy[-le-Château] a 50 hectares cultivés cette année sur les 15 000 avant guerre. » Lettre du 31 août 1919, p. 120.
[8] p. 121.
[9] Voir pp. 82-87.
[10] Voir notamment la lettre du 24 février 1919, p. 34.
[11] Une notice portant sur ses mémoires lui a été consacrée sur ce site, dans la partie consacrée au témoignage.
SAINT-FUSCIEN Emmanuel, A vos ordres? (par André Bach)
Recension de Emmanuel Saint-Fuscien, A vos ordres ? La relation d’autorité dans l’armée française de la Grande Guerre, éditions de l’EHESS, Paris, 2011, 310 pages
En prenant en mains le livre d’Emmanuel Saint-Fuscien, j’ai été saisi d’une sourde inquiétude en contemplant la couverture. Cette image de propagande renvoie au pire bourrage de crâne pour gogos de l’arrière. Qu’elle soit l’œuvre d’un officier du front, le médecin-aspirant Laby ne peut qu’interroger pour savoir ce qui l’a poussé à imaginer une scène aussi surréaliste, qu’il n’a certes pas vécue, sachant que si le cas s‘était présenté, il n’aurait pas pu recommencer une deuxième fois, la réaction normale de l’officier adverse étant de donner en priorité l’ordre à un de ses tireurs d’élite, de bien prendre sa visée et abattre calmement cette silhouette bien repérable grâce aux éclats du mica protecteur de son porte carte. Les multiples écrits de cadres que je qualifie de « baroudeurs », sous-officiers, officiers subalternes, voire colonels ou généraux, s’inscrivent en faux contre cette manière de lancer des assauts. Ce n’est pas comme cela qu’on fait se lever une troupe.
Un domaine encore non exploré par les universitaires
Ceci dit, il faut plutôt parler du contenu que de l’enveloppe. Et là, il faut le dire, il s’agit d’une étude remarquable et novatrice portant sur ce que Emmanuel Saint-Fuscien appelle un point aveugle dans l’historiographie universitaire et militaire de la grande Guerre et des autres guerres d’ailleurs : la relation d’autorité entre cadres de contact et hommes de troupes en période de conflit. Jusqu’à présent n’ont été mises en scène que la strate politico-militaire en charge, en haut, de la conduite de la guerre et en bas la masse indistincte des combattants, en oubliant qu’entre les deux existe un chaînon absolument décisif, celui qui traduit les ordres du haut en réalisation au niveau de la base : les sous-officiers et officiers de contact. De ce fait, et pour expliquer ce qui évidement semble inexplicable si l’on en reste à ce schéma, à savoir la ténacité des hommes qui ont continué à se battre plus de quatre ans, on n’a eu jusqu’à présent recours qu’à deux familles de représentation. En gros, l’une explique cette endurance par le fait que la masse des hommes a consenti à cette guerre et que donc logiquement cette dernière ne pouvait que durer jusqu’à la victoire finale. L’autre explique que la troupe était consciente de l’appareil de répression, terrible, qui la menaçait, et que de ce fait elle a subi, contrainte et forcée, une situation à laquelle elle ne pouvait échapper. On est là, bien sûr, dans une description de modèles idéaux wébériens, de modèles « chimiquement purs », qui ne sont, évidement, défendus par aucun chercheur. A parcourir les travaux des uns et des autres, on se rend bien compte que ces derniers empruntent à ces deux familles de représentation selon un dosage qui permet d’entretenir le débat entre ceux qui se rapprochent plus du premier modèle et ceux qui sont plus enclins à emprunter au second.
La thèse passionnante de l’auteur ouvre une voie qui permet d’échapper à ce ronronnement. Il a, avec finesse, compris que pour analyser les hommes en guerre, la première approche se devait d’être anthropologique. Avec la prostitution, la guerre est une des plus vieilles habitudes humaines, et elle est régie par des types de relations immémoriales qui survivent à tous les systèmes sociaux humains et ne sont guère affectés par eux. La guerre n’est pas équivalent à une catastrophe naturelle, les rapports entre hommes y sont différents de ceux de la vie courante. Les combattants sont en permanence susceptibles d’être soumis au stress, à la peur, dans un environnement qui leur rappelle le côté précaire de l’existence[1]. Les relations avec ceux qui les encadrent ne sont pas celles en vigueur dans la société de temps de paix. Les huit millions de mobilisés ont été encadrés par près de 200 000 officiers, plus que l’armée française d’aujourd’hui et par 3 fois plus de sous-officiers.
Croire qu’il suffit d’établir un règlement pour lancer à la mort les combattants, en dehors de fanatisme idéologique ou religieux, c’est raisonner en termes d’images d’Epinal. L’obéissance gît dans le tissu de relations interpersonnelles créées au sein de cet environnement apocalyptique, chaotique, inconfortable, qu’est la guerre.
Il ne s’agit pas d’une relation à sens unique du haut vers le bas, mais d’interrelations qui transforment les relations des uns et des autres au fil des événements. On n’obéit pas de la même manière à un officier ou sous-officier chevronné et à un jeune aspirant. Chaque cas est unique et différent. Chefs comme exécutants évoluent mentalement en se frottant et se confrontant les uns aux autres lors de la mise en œuvre des ordres reçus au cours d’échanges implicites.
Une vision idéologique de la discipline
Ce qui est fascinant dans le cas français est que la jeune III° République a essayé de dépasser ce mode immémorial de commandement en imaginant qu’il pourrait être remplacé par une discipline consentie, impersonnelle, fondée sur la conscience civique. Il fallait ne plus obéir à un officier, mais à la Nation, de la volonté de laquelle il était la représentation physique.
Désobéir à la hiérarchie c’était désobéir à soi-même, détenteur d’une parcelle de la souveraineté populaire.. Cette conception en son temps, était proprement révolutionnaire et décriée et moquée par les autres armées essentiellement impériales et royales en Europe. Les officiers allemands daubaient sur cette Parliamentsheer, armée de parlement, de discutailleurs, caricature d’armée, scandale permanent qui ridiculisait « le noble métier des armes »…
Dans la première partie du livre jusqu’à la page 121 Emmanuel Saint-Fuscien décrit tout d’abord ce que fut cette tentative théorique, rhétorique et ce qu’il en est advenu au fil de la guerre. Il faut saluer la richesse de la documentation recueillie et sa mise intelligente en perspective.
Cette partie descriptive et analytique est très riche et convaincante et montre l’autorité dans tous ses états dans l’armée en guerre et dans les espaces de la guerre : l’arrière, les cantonnements, les espaces sanitaires.
Pour mesurer la nature et le volume des entorses à cette autorité, l’auteur a entrepris ensuite d’analyser les 1329 jugements produits par le Conseil de guerre de la 3° Division d’Infanterie.
Leur exploitation est très intelligemment menée en 75 pages mêlant les faits et leur interprétation.
Il rend ainsi visible un apparent paradoxe qui est que, alors que la représentation nationale a essayé d’inventer une nouvelle manière d’obéir, qu’on peut estimer d’ordre idéologique, elle n’a pas touché à l’esprit d’un code de Justice militaire promulgué sous Napoléon III, complètement déphasé par rapport à la nouvelle idéologie inculquée.
L’auteur montre bien qu’il s’agit d’une justice totalement différente, dans son fonctionnement de son homologue civile. C’est une justice d’exemplarité où « Ce sont moins les faits eux-mêmes qui comptent que les conditions dans lesquelles ils ont lieu », page 177.
Cela entraîne des jugements incompréhensibles selon les normes civiles et de nombreux exemples en sont donnés. Le paradoxe se donne surtout à voir dans la troisième partie qui analyse chronologiquement l’évolution au fil de la guerre.
Une érosion lente, accélérée en 1917, de cette construction idéologique
L’auteur fixe avec juste raison un tournant dans les pratiques d’autorité à l’été 1916.[2] C’est à cette période que le Parlement emmené par le député Paul Meunier impose une réforme de la Justice militaire qui la met en phase avec l’aspiration républicaine de pratique d’une obéissance impersonnelle consentie. Or, c’est aussi le moment où ce type d’obéissance est en train de finir de décliner sous le poids des épreuves. En effet, alors que la Justice militaire offre enfin, politiquement, des garanties contre l’arbitraire, l’obéissance est de plus en plus obtenue uniquement par la qualité des relations interpersonnelles entre hommes et officiers, alors que menace la « rupture des liens hiérarchiques ».
Plus que jamais l’obéissance va dépendre de la qualité des cadres : exemplarité, sens de la justice, souci du bien-être des hommes, de leur préservation, telles sont, d’ailleurs, les principales recommandations diffusées du GQG Pétain pour recréer les liens hiérarchiques mis spectaculairement à mal pendant les mutineries.
On va donc terminer la guerre avec des relations d’autorité fortement transformées. Partis en guerre avec un discours théorique qui privilégiait l’impersonnalité dans les relations d‘autorité et une justice militaire non protégée de l’arbitraire, les hommes l’ont terminé avec une justice en voie de civilianisation avancée et des relations de commandement fondées sur un plus ou moins grand attachement personnel aux cadres de contact.
Plus audacieusement l’auteur se demande si cette pratique de recours au chef n’est pas pour quelque chose dans les pulsions de l’entre-deux guerres vers des mouvements populistes, voire fascistes, selon l’auteur, dans une période où l’espoir mis avant 14 dans le système politique est bien atténué et où le recours aux types de relations au front pourrait être une alternative à la gestion de la vie publique.
On ne peut résumer ainsi en quelques pages ce passionnant livre qui en fait 300, ponctué d’une bibliographie abondante et diversifiée qui témoigne de l’ampleur des sources consultées.
Des questions en débat
Quid des mutineries ?
Le fait, toutefois, de n’avoir pris en compte les condamnations que d’une seule division fait passer à côté de certaines questions qui restent sous-jacentes. A la 3° Division, il n’y a eu que 7 exécutés.[3] Sur l’ensemble du front il y en a eu plus de 650, et, surtout en 1914-1915 bon nombre suite à des jugements plus que contestables, menés dans des conditions frisant le scandale
Il y a là, bien évidemment matière à discussion et à débat.
Tout d’abord n’avoir pris en compte que la 3° Division n’a pas permis à l’auteur d’approfondir sa réflexion sur les mutineries. En effet, cette division a été peu secouée par ce phénomène bien que le 128° RI se soit distingué avec ses deux condamnés à mort, Lamour et Breton. De ce fait l’auteur esquive la question de l’importance politique de ce mouvement, et pour cela, il faut donc lire en complément l’indispensable livre d’André Loez[4] . En effet et sans aller plus loin, il est notable qu’en dépit, en de nombreux régiments, de relations interpersonnelles de qualité entre hommes et cadres, les premiers sont entrés dans la désobéissance collective, preuve d’une dynamique passant outre ces bonnes relations. A chaud, bon nombre de ces cadres, à la conduite exemplaire, qui avaient de l’ascendant et étaient appréciés ont été considérés comme des boucs émissaires, punis et changés d’unités. Cela découlait de la logique qui prévalait chez un commandement qui se refusait à reconnaître la dimension insurrectionnelle des manifestations et n’y voyait, officiellement, que des aspirations ponctuelles au repos.
Des exécutions « consenties » ?
Ensuite, en conclusion apparaissent des notions qui ne vont pas de soi pour l’historien que je suis devenu et l’officier que je fus
Je cite :
« La pression disciplinaire fut plus forte au début qu’à la fin du conflit, car la contrainte exercée par les uns s’était adossée au consentement des autres »[5]
Car « Plus l’adhésion du soldat est forte, plus l’arbitraire et la violence peuvent s’exercer dans la pratique du commandement »[6]
ce qui ressortirait nettement de l’étude des diverses sources : « L’histoire de la relation d’autorité tout au long de la guerre laisse apparaître une nette corrélation entre force de l’adhésion et autoritarisme des chefs »[7]
C’est un postulat non démontré et si corrélation ou covariance il y a, rien n’y incite à y voir un lien de causalité. Peut-on considérer que le nombre élevé d’exécutions dans la Wehrmacht ou l’Armée soviétique, le non recours aux exécutions dans l’armée américaine au cours de la 2ème guerre mondiale sont à expliquer par le plus ou moins grand degré d’adhésion des soldats à la cause à laquelle ils croyaient ?
Peut on conclure du nombre élevé d’exécutions à la 45° DI, (23) composée de tirailleurs nord-africains et de Bat d’Af, que cette division doit être donnée en modèle à l’armée française comme exemple d’adhésion ininterrompue à cette guerre ? Ou la 37° DI avec ses 17 exécutions, composée entièrement de troupes issues d’Afrique du Nord ?
Toute hiérarchie militaire dispose de moyens matériels et immatériels de se faire obéir. Peut-on considérer que les soldats en 1958 ont adhéré au putsch qui a renversé la IV° République puisqu’ils n’ont pas manifesté leur désapprobation ? qu’ils ont adhéré à la pratique de la torture puisqu’ils se sont tus sur le moment ? L’Armée n’est pas la société civile. Quand un communiqué paraît disant « L’Armée pense que… » il faut lire que « Le plus haut gradé de l’Armée (ou un collège de hauts gradés, pense que… ») et non qu’il s’agit de l’opinion unanime de la collectivité militaire.
Dire que l’Armée a pu obtenir sans difficulté la création du principe de création des conseils de guerre spéciaux ne doit s’énoncer que si on précise le contexte, à savoir l’atmosphère de panique devant la déroute de nos armées fin août 1914. Sans cela, il ne serait certainement pas venu à l’idée de la hiérarchie de surenchérir sur un code de Justice militaire déjà amplement terrorisant.
Une coïncidence chronologique qui n’en est pas une
Considérer que la baisse du nombre des exécutions est corrélée avec « les premières fractures significatives du consensus » est faire peu de cas de l’effet de la loi du 27 avril 1916 qui apporte enfin des garanties à la défense.
On pourrait défendre l’idée que ce n’est pas un hasard si cette loi a été promulguée justement à un moment de basculement de l’opinion des hommes, qu’il y a là une corrélation exemplaire. Or cette loi aurait du paraître bien plus tôt. En effet elle avait été votée à l’unanimité à la Chambre le 10 décembre 1915 ( 461 votants) Si elle n’a pu avoir force de loi plus tôt, c’est que le Sénat qui durant toute la guerre, sera du côté de l’exécutif et du Haut Commandement, a attendu, sans se presser 4 mois avant de statuer et ce par un rejet le 12 avril . La Chambre ne suivit pas cet exemple. 5 jours après elle renouvelait son vote à l’unanimité, forçant l’exécutif à la promulguer dans les dix jours qui ont suivi. Cette loi avait été réclamée depuis début 1915 par la Commission de la Législation Civile et criminelle de l’Assemblée. Aurait-t-on donc eu des soldats consentants et des députés réticents, à l’unanimité ? Doit-on considérer que le Sénat est un meilleur marqueur du degré d’adhésion de la population à la guerre que l’Assemblée ?
Ce point ne se trouve que dans deux pages de la conclusion, mais il met en lumière que sur le plan universitaire il y a bien un débat en cours, non tranché, sur la vision des conditions d’exécution de cette guerre. Il doit se continuer et s’affiner.
Sur ce point et, eu égard aux sources, je pense que le paradigme énoncé ne se révèle pas valide.
Que cette prise de position ferme, personnelle, ne dissuade pas de lire cet- excellent ouvrage, fruit d’une recherche rigoureuse. Personnellement je déconnecte cette partie des conclusions du reste de l’ouvrage car ce dernier ne sert en aucune manière de démonstration à la conclusion précitée. En tout cas je ne l’ai pas perçue. Cet ouvrage est en réalité le premier à jeter une lueur fine et perspicace sur ce maillon du commandement intermédiaire des hommes et apporte du neuf dans le fonctionnement du « peuple des tranchées », et en cela il est novateur et indispensable à lire pour ceux qui veulent comprendre comment fonctionne une armée en guerre.
Comme on a pu le voir le livre est très descriptif. Sa richesse documentaire est la bienvenue et elle permet à l’auteur de donner à voir comment les relations interpersonnelles, d’ordre anthropologique, jouent un rôle dans le maintien des hommes sous le feu..
Ainsi en peu de temps saluons la chance que nous avons de pouvoir bénéficier de la parution de travaux aussi brillants que ceux d’André Loez et d’Emmanuel Saint Fuscien. Solides, mesurés, attachés aux faits, ne dissimulant pas toutefois les divergences de fond qui les séparent, ils augurent bien des travaux des jeunes chercheurs qui les suivent et auxquels ils montrent la voie pour un renouvellement, sans complexe, de l’histoire de la Grande Guerre.
André Bach
[1] La génération qui a connu la guerre d’Algérie sait de quoi je veux parler. Mais elle est la dernière, bien heureusement à avoir fait, cette expérience. Les jeunes chercheurs universitaires auront donc du mal à décrire ce ressenti, qui de tous temps n’est évoqué qu’entre « camarades du feu ».
[2] mon ouvrage à paraître début 2013 sur la Justice militaire en 1916 mettra particulièrement l’accent sur ce tournant de l’été 1916.
[3] On ne peut donc pas généraliser. La 45° DI a exécuté 23 des siens, la 37° DI 17.
[4] Loez André, 14-18, Les refus de la guerre. Une histoire des mutins, Paris, Gallimard, coll. » Folio Histoire », 2010.
[5] page 261, paragraphe « Les limites de l’autoritarisme ».
[6] page 261 idem.
[7] Ibidem.
HADDAD Galit, 1914-1919, Ceux qui protestaient (par R. Cazals)
HADDAD Galit, 1914-1919, Ceux qui protestaient, Paris, Les Belles Lettres, 2012, 436 p. (préface de Stéphane Audoin-Rouzeau, p. 7-9).
Qui publie en 2012 sur un tel sujet prend le risque de voir son livre comparé à l’ouvrage remarquable d’André Loez, édité en 2010 (14-18, Les refus de la guerre, Une histoire des mutins, Paris, Gallimard, collection « Folio-Histoire », 690 p.). Disons d’abord que, chez Galit Haddad (GH), contester l’apport d’André Loez en employant des termes désobligeants n’est pas de bonne méthode. Si l’on veut pouvoir dire qu’il y a dans le livre d’André Loez une « confusion sciemment établie entre soldats pratiquant différents modes de désobéissance tout au long du conflit, depuis 1914 jusqu’aux mutineries de 1917 », il faut le prouver, et ne pas enchaîner sur cette incohérence : « tout refus de combattre ne signifie pas nécessairement une mise en cause des objectifs au nom desquels on combattait. Ainsi est-il sans doute indispensable d’effectuer une distinction conceptuelle entre refus de combattre et refus de la guerre : un rejet du combat ne signifie pas de manière univoque une mise en cause de la guerre elle-même et de ses buts » (p. 223). Aux pages suivantes, on trouve encore que Loez « se garde d’aborder » le contre-refus, qu’il « ne veut entendre que le seul discours du refus à l’appui de la thèse qu’il souhaite avancer ». Or, si on prend le livre d’André Loez p. 278-285, on rencontre ceux qui ont refusé les mutineries. GH nous dit encore que les travaux sur les mutineries se sont focalisés sur les actes et ont oublié le discours, ne voyant ainsi qu’une facette de la contestation (p. 28). Or le livre d’André Loez est plein de la parole des mutins. D’autres aspects de ce livre sont caricaturés par GH. Ainsi les 18 pages (39-56) d’André Loez où il explique soigneusement comment l’entrée en guerre a été « une évidence collective » sont « résumées » de manière tendancieuse en une expression (GH, p. 221) : la guerre « s’impose à l’individu qui n’a d’autre choix que d’obéir à l’autorité militaire, sans contestation possible ». Venons-en au fond du propos.
Ce livre est d’abord très intéressant parce qu’il remet en cause l’affirmation de Stéphane Audoin-Rouzeau et Annette Becker selon laquelle il a existé une « vieille complaisance historiographique pour les refus plutôt que pour les consentements[1] ». Ici, GH affirme que l’histoire de la Première Guerre mondiale a laissé dans l’ombre ceux qui protestaient. Sa conclusion est éloquente (p. 385-386), rappelant « la constance avec laquelle l’historiographie de la Grande Guerre a vu dans le discours de la protestation un phénomène marginal », revenant sur le fait que, après l’action de la censure, la voix de la contestation « fut comme étouffée une seconde fois dans le secret des cartons poussiéreux des archives de la Défense ». Elle ajoute : « Et même ces cartons une fois ouverts – il y a de cela quarante-cinq ans environ -, ces cris des combattants n’ont pas bénéficié de toute l’attention qu’ils eussent été en droit d’attendre de la part des historiens[2]. » En fait, même si elles sont en contradiction frontale, les deux affirmations, de SAR et AB d’une part, de GH d’autre part, sont fausses. D’une part, les grandes thèses de Jean-Jacques Becker, Jules Maurin et Antoine Prost, les livres importants de Ducasse, Meyer et Perreux, de Marc Ferro et de Duroselle n’ont pas cherché à privilégier les refus, mais à faire de l’histoire. Et, d’autre part, plus récemment, la publication de témoignages de combattants, carnets personnels ou correspondances, Barthas, Bès, Bousquet, Mauny, Rouvière, Tanty, Vandrand, etc. (dont nous reparlerons) a mis la protestation combattante à portée des historiens voulant se documenter sérieusement.
GH a fait le choix de ne pas étudier les actes et les pratiques, de s’en tenir aux discours. Elle examine le discours pacifiste chez les civils, les protestations des soldats et les éventuelles interactions entre le front et l’intérieur. Son livre nous remet en mémoire le rôle des femmes (Marcelle Capy, Hélène Brion…), des instituteurs, des anarchistes (Louis Lecoin, Sébastien Faure…), des socialistes de Zimmerwald et Kienthal… Elle montre l’espoir suscité par Stockholm ; elle souligne le caractère pacifiste des grèves de 1918 ; elle aborde, au moment de la victoire, les préoccupations des pacifistes concernant le type de paix. Chez les combattants, elle sait voir les effets de la venue de l’hiver sur le « moral[3] », et le rôle des destructions pratiquées par les Allemands dans leur retraite dans la remobilisation des Français en 1918. Auparavant, elle avait consacré une page (170-171) au thème « S’identifier à l’ennemi », mais en oubliant trêves et fraternisations qui sont cependant bien documentées et qui ont donné lieu à du discours protestataire relevé par le contrôle postal[4]. GH montre de l’empathie pour les protestataires en fournissant de longues et belles citations, qu’il s’agisse de la lettre d’une femme allemande (p. 129 : « Je sais, je sais, mon chéri, que je ne te verrai plus »), de la déclaration d’Hélène Brion devant ses juges (p. 282 : « Je comparais ici comme inculpée de délit politique : or je suis dépouillée de tous droits politiques »), d’un article de Pierre Brizon dans La Vague, 12 septembre 1918 (p. 339 : « A supposer qu’il puisse jamais y avoir dans cette guerre un vainqueur écrasant, il tomberait mourant dans le cimetière du vaincu »).
En même temps, le livre donne l’impression que GH cherche à atténuer autant que possible le poids de la protestation pour ne pas heurter de front la théorie du consentement. On a vu son attitude de dénigrement de la thèse d’André Loez ; il faut signaler ses lacunes concernant les sources et la bibliographie. Les colloques proches du CRID 14-18, Paroles de paix en temps de guerre (cinq communications sur 14-18) et La Grande Guerre, pratiques et expériences ne sont pas connus[5]. Si le colloque Obéir/désobéir est cité en bibliographie, le texte de réflexion de Nicolas Mariot, membre du CRID, sur mutins et non-mutins n’est pas utilisé, alors qu’il est au cœur du problème soulevé par GH p. 238 et suivantes[6]. Dans l’index de GH, Antoine Prost apparaît une seule fois pour le livre rédigé avec Jay Winter[7] ; François Cochet, Marc Ferro, Jules Maurin, Frédéric Rousseau n’apparaissent pas du tout.
La position inconfortable de GH entre l’empathie pour son sujet et le carcan théorique qu’elle suit se traduit par une série de contradictions. J’en ai relevé quelques-unes :
– P. 35, on lit : « De fait, dans la mesure où la production culturelle a été à l’unisson du consensus national tout au long de la guerre, on pourrait presque dire que la censure n’était pas ‘nécessaire’. » Voilà pour la théorie mais, quelques pages plus haut (p. 17) GH avait noté que l’Etat avait « exercé une censure draconienne sur toutes les publications susceptibles de mettre en cause le bien-fondé de la thèse de la Défense nationale ».
– P. 72, la protestation pacifiste qui dit en septembre 1915 : « aucune raison humaine ne peut justifier la prolongation indéfinie de cette gigantesque tuerie » est détournée de son sens lorsque GH en conclut qu’elle exprime l’idée que « la guerre n’était acceptable qu’à condition d’être courte ».
– P. 89-90, une phrase de Léon Werth qui compare les soldats à des « bêtes de troupeau et d’abattoir, qui n’osent pas haïr leurs maquignons et leurs bouchers » indiquerait, d’après GH, qu’il s’agit moins « de les présenter comme des victimes (comme chez Jean Giono par exemple) ou des sacrifiés, que de faire ressortir leur docilité et leur soumission ». Il me semble, pourtant, que « abattoir » et « bouchers » s’accordent assez bien avec « victimes » et « sacrifiés ».
– P. 244, on peut lire que les familles, à l’arrière, « réprouvent sans ambages toute infraction aux règles militaires », ce qui est « l’illustration même que tout acte de protestation en temps de guerre reste illégitime pour le ‘front intérieur’ ». Mais on apprend plus loin (p. 249) que les soldats reçoivent dans leurs lettres des coupures de presse annonçant les grèves et critiquant « la guerre, la patrie et les chefs ».
– P. 334, on signale le silence des pacifistes dans la deuxième partie de 1918, à l’exception du journal La Vague ; mais (p. 290), on nous avait informés que La Vague tirait à plus de cent mille exemplaires à cette époque ; il s’agit donc d’un « silence » assez bruyant.
– Sur la même page (346), à propos des derniers mois de guerre, la formule « la protestation combattante n’existe tout simplement plus » est commentée ainsi : « La terminologie empruntée à l’univers de l’abattage, les formules exprimant le ‘cafard’, les réquisitoires idéologiques, la haine de l’arrière, ou encore la mise en cause de la culture de guerre, tout cela devient moins récurrent dans la correspondance combattante. »
– P. 349, pour « prouver » qu’en août 1918 les soldats sont remobilisés pour la victoire, GH utilise une citation qui se termine par « nous pourrons dire ‘ouf’ ».
– P. 363, toujours à partir de l’été 1918, la confusion devient complète dans cette phrase : « Nous n’avons en réalité à notre disposition que des extraits éparpillés dont l’opinion, désormais écrasante, se situe à contre-courant d’un consentement combattant. » J’ai copié cette phrase avec une totale attention. Sans doute y a-t-il quelque part un lapsus qui la rend incohérente, et cela nous conduit à une nouvelle rubrique qui arrive malheureusement trop tard pour GH.
Sur le plan formel, le volume contient un nombre incalculable de fois l’expression [sic] après une faute d’orthographe ou de français dans la citation d’une lettre de soldat, mais pas après toutes les fautes. Dans de nombreux cas, on ne sait pas si ces [sic] sont dus à GH ou au censeur postal qui a rédigé son rapport et recopié la phrase du combattant ; mais dans certains cas, il est clair qu’ils sont de GH (notamment p. 110, lettre citée par Thierry Bonzon et Jean-Louis Robert[8] qui, eux, ne s’étaient pas permis d’ajouter des [sic]). Je dis toujours à mes étudiants : lorsque vous citez le texte d’un témoin, n’utilisez pas la formule [sic] s’il commet des fautes car je trouve cela un peu méprisant ; dites une fois pour toutes : « orthographe des originaux respectée ». Et à présent je dis à ceux qui souhaiteraient, dans quelques années, citer des phrases de GH elle-même, n’ajoutez pas des [sic] pour signaler les nombreuses coquilles dans son propre texte[9].
– On aurait pu conseiller à GH d’éviter cette expression naïve à propos de la lettre du front (p. 23) : « Sa dimension subversive ne réside pas dans son genre discursif : celui-ci n’est pas polémique ou illégal, comme le sont les tracts ou la presse clandestine de l’arrière. Ce qui rend subversives ces lettres, ce sont les propos non-conformistes qui parfois s’y lisent. » La phrase qui nous dit qu’en août 1914 « les voix pacifistes qui s’élevaient avant la guerre se taisent » (p. 31) aurait pu être complétée par la mention de la voix qu’on avait fait taire par l’assassinat de Jaurès le 31 juillet.
– Le film Les Sentiers de la Gloire n’a pas été interdit en France comme l’écrit GH (p. 14), mais on ne va pas retenir une erreur mineure puisque les spécialistes nous disent qu’il n’a pas été présenté à la Commission de contrôle par crainte d’interdiction[10]. Par contre, mieux valait ne pas ajouter que, en 1957, lors de la sortie du film, la France était « alors à peine sortie de la guerre d’Algérie ». Autre erreur p. 103 et répétée p. 131 : « En déclenchant l’offensive de Verdun, les Allemands voulaient ‘saigner à blanc’ les Français… » Les historiens allemands ont montré que cette vision des choses, n’avait été affirmée par Falkenhayn que dans un texte tardif destiné à cacher l’échec de son véritable plan qui était de prendre Verdun[11]. Il aurait également fallu relire la phrase de la p. 289 qui semble très bizarre : en mai 1918, les femmes de Firminy auraient marché vers la gare « pour empêcher les mobilisés des classes 1911, 1912 et 1913 de partir ». Or ces mobilisés étaient partis dès 1914. S’agit-il d’ajournés récupérés par les conseils de révision ? d’affectés spéciaux renvoyés sur le front ? ou de tout autre chose ? On ne sait.
– Terminons cette rubrique avec la chanson de Craonne sur laquelle, nous dit GH p. 210, « on possède très peu d’informations ». Ceux qui ont lu les Carnets de guerre du tonnelier Barthas ont pu la rencontrer au moment où il décrit les mouvements d’indiscipline de 1917 dans son unité (p. 471-472). Ceux qui ont cherché à trouver beaucoup d’informations sur la chanson de Craonne ont pu lire l’article très documenté de Guy Marival dans le livre collectif à l’origine de la création du CRID 14-18. C’est encore une lacune dans la bibliographie très sélective de GH[12].
Le problème principal de méthode concerne les sources de la parole combattante. D’après GH (p. 25), la parole protestataire des combattants ne serait « accessible que par le biais des rapports des archives du contrôle postal », ce qui fera sursauter beaucoup de ceux qui connaissent la question, même si GH apporte la mince nuance : « complétés parfois par d’autres sources sur certains aspects ». Les rapports du contrôle postal sont une source très insuffisante. D’une part, il ne s’agit que de sondages et GH n’a consulté que 32 liasses, se limitant à la IIe armée. D’autre part, ces contrôles sont restés mal organisés avant 1916-1917 : rien d’étonnant à ce qu’on rencontre peu de protestations dans cette source avant cette date. GH en a eu conscience et elle annonce (p. 83) un « détour » pour « combler – au moins partiellement – ce déficit de sources : le passage par les témoignages combattants ». Finalement « les » témoignages combattants se réduisent à un seul, celui de Léon Werth, certes intéressant, mais il faudra revenir sur cette absence de curiosité. Restons sur les limites du contrôle postal en tant que source. La synthèse rédigée par le censeur peut être orientée par l’état d’esprit du rapporteur lui-même. Les rapports permettent rarement de connaître le grade de l’auteur des lettres citées, et jamais son statut social dans le civil (alors que la publication d’un corpus de lettres, si elle est bien faite, nous renseigne sur l’auteur et montre son évolution). Les trop courtes citations restent quelquefois ambiguës. En ce qui concerne les non-mutins, par exemple, condamnent-ils la mutinerie de leurs camarades par principe, ou parce qu’ils sont victimes de punitions collectives causées par les troubles, ou encore pour affirmer à leur famille (et à la censure) qu’ils n’ont pas participé eux-mêmes au mouvement ? Ce qui devait être un apport décisif se révèle bien mince, du fait de l’insuffisance de la source. Ajoutons, ce que ne dit pas GH, que les censeurs ont classé les lettres en trois catégories : « bonnes », « mauvaises » et « sans intérêt », et que la troisième catégorie représente souvent autour de 90 % du total. Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie que ceux qui ont de « bons » sentiments, alors que rien ne les empêche de les exprimer, sont peu nombreux. Que ceux qui expriment de mauvais sentiments sont peu nombreux aussi, mais peut-être parce qu’ils craignent la censure, pas vraiment par peur pour leur personne, mais pour ne pas risquer de voir interrompre le lien qui les rattache à leur famille[13].
Le témoignage du combattant Léon Werth n’est utilisé par GH que pour la période 1914-1915. Pour la suite, elle se contente des rapports du contrôle postal dont nous venons de voir les limites comme source. Il n’est donc pas étonnant qu’elle ne voie apparaître les formules non-conformistes des combattants qu’à partir de l’automne 1916 (p. 159), ou encore (p. 175) : « A la fin de l’année 1916, les premiers signes de protestation apparaissent dans la correspondance des soldats, et bien qu’ils soient encore dérisoires, leur existence est en soi significative : elle annonce une nouvelle tendance dans le discours combattant. » Alors, oui, la durée de la guerre rend ce discours de plus en plus vif, mais il existe depuis 1915, voire depuis l’automne 1914. Si GH avait voulu consulter le dictionnaire des témoins sur le site du CRID, elle aurait pris connaissance des témoignages de Charles Auque, Jean Bec, Victorin Bès, Joseph Bousquet, Paul Corbeau, Louis Duchêne, Marcel Garrigue, Emile Mauny, Léopold Noé, Delphin Quey, Maurice Pensuet, Charles-Henri Poizot, Camille Rouvière, Etienne Tanty, Gabriel Thivolle-Cazat, Elie Vandrand, etc. Elle aurait vu que la critique des attaques stériles, des embusqués et des gros profiteurs, du bourrage de crâne, que l’attente angoissée de la fin, que tous ces éléments de la parole protestataire sont présents dans les carnets personnels et les correspondances des combattants dès 1915, voire dès l’automne de 1914. Elle aurait vu que, dès octobre 1914, Etienne Tanty crie sa haine des « apologistes du carnage » ; dès novembre, il s’en prend au bourrage de crâne ; en mars 1915, il se considère comme « bétail humain, parqué pour l’abattoir » ; en avril, il écrit qu’il a soupé de la patrie ; en juillet qu’il voudrait que soient bombardés « l’Elysée, la Wilhelmstrasse, les Parlements, les salons, les hôtels de journaux et cette vieille crapule de pape[14] ». Chez Emile Mauny, GH aurait trouvé d’autres éléments, comme l’interdiction à sa femme de participer aux emprunts de la Défense nationale pour ne pas allonger la durée de la guerre. Si GH avait bien voulu lire une des communications présentées au colloque Paroles de paix en temps de guerre, elle aurait eu connaissance de ces multiples « utopies brèves » présentes dans les témoignages publiés : pour mettre fin à la guerre, l’espoir dans l’action des neutres, ou dans l’arrivée du choléra pour détruire les armées, ou encore dans le refus de travailler les champs et de produire[15].
Ce n’est pas le lieu de commencer la rédaction d’un livre sur le discours protestataire des combattants d’après un corpus sérieux. Il suffit de dire que GH n’a pas su le constituer, ce qui représente la critique décisive à faire à son livre.
Rémy Cazals
[1] Stéphane Audoin-Rouzeau et Annette Becker, 14-18, Retrouver la guerre, Paris, Gallimard, 2000, p. 127.
[2] A propos de « cri », on peut signaler à GH le livre de Rémy Cazals et Frédéric Rousseau, 14-18, le cri d’une génération, Toulouse, Privat, 2001, qui ne figure pas dans sa bibliographie.
[3] Voir une intéressante réflexion d’André Loez, « Pour en finir avec le ‘moral’ des combattants », dans Combats, Hommage à Jules Maurin, sous la dir. de Jean-François Muracciole et Frédéric Rousseau, Paris, Michel Houdiard, 2010, p. 106-119.
[4] Mais GH ignore aussi le livre collectif international Frères de tranchées, Paris, Perrin, 2005.
[5] Paroles de paix en temps de guerre, sous la dir. de Sylvie Caucanas, Rémy Cazals et Nicolas Offenstadt, Toulouse, Privat, 2006 ; La Grande Guerre, pratiques et expériences, sous la dir. de Rémy Cazals, Emmanuelle Picard et Denis Rolland, Toulouse, Privat, 2005.
[6] Nicolas Mariot, « Pour compter les mutins faut-il soustraire des moutons ? », dans Obéir/désobéir, Les mutineries de 1917 en perspective, sous la dir. d’André Loez et Nicolas Mariot, Paris, La Découverte, 2008, p. 345-372.
[7] Antoine Prost et Jay Winter, Penser la Grande Guerre, un essai historiographique, Paris, Seuil, collection « Points-Histoire », 2004.
[8] Nous crions grâce, 154 lettres de pacifistes, juin-novembre 1916, présentées par Thierry Bonzon et Jean-Louis Robert, Paris, Les éditions ouvrières, 1989, p. 56.
[9] En ce qui concerne la forme, le fait que les notes et les appels de notes soient déconnectés de la p. 349 à la p. 359 introduit une difficulté de lecture supplémentaire.
[10] Albert Montagne, « Verdun et la Grande Guerre sous le casque de la censure cinématographique », dans Les Cahiers de la Cinémathèque, Revue d’histoire du cinéma, n° 69, novembre 1998, « Verdun et les batailles de 14-18 », p. 72.
[11] Voir Gerd Krumeich, « ‘Saigner la France’ ? Mythes et réalité de la stratégie allemande de la bataille de Verdun », Guerres mondiales et conflits contemporains n° 182, p. 17-29.
[12] Guy Marival, « La Chanson de Craonne, De la chanson palimpseste à la chanson manifeste », dans Le Chemin des Dames, De l’événement à la mémoire, sous la dir. de Nicolas Offenstadt, Paris, Stock, 2004, p. 350-359.
[13] Voir Frères de tranchées, op. cit., p. 101 et suivantes.
[14] Le pape est pris à partie parce qu’il n’a pas su ou voulu empêcher la guerre ou y mettre fin. Si l’exemple de Tanty est développé ici au lieu de beaucoup d’autres, c’est que la publication de ses lettres ne doit rien à un quelconque membre du CRID : Etienne Tanty, Les violettes des tranchées, Lettres d’un Poilu qui n’aimait pas la guerre, Paris, Editions italiques, 2002 (préface d’Annette Becker). L’ignorance de l’existence de ce livre par GH est d’autant plus étonnante que Tanty appartenait au 129e RI, unité qu’elle a choisie comme étude de cas pour parler des non-mutins de 1917.
[15] Rémy Cazals, « Méditations sur la paix d’un combattant de 1914-1915 », dans Paroles de paix…, op. cit.
LITALIEN Michel, Écrire sa guerre. Témoignages de soldats canadiens-français (par Frédéric Rousseau)
Michel Litalien, Écrire sa guerre. Témoignages de soldats canadiens-français (1914-1919), Outremont, Athéna éditions, 2011, 307 pages.
Gestionnaire du réseau des musées des Forces canadiennes à la Direction Histoire et Patrimoine, Michel Litalien fait à nouveau œuvre utile d’historien avec ce livre présentant des témoignages de soldats canadiens-français. Notons tout de suite que ces témoignages de francophones sont rares, surtout en comparaison des nombreux témoignages publiés et connus de combattants anglophones. Les historiens ont jusqu’ici soutenu l’idée que cette rareté tenait à l’illettrisme encore largement dominant au Québec à la veille de la Grande Guerre. Il est hors de doute que cette situation a pesé sur le volume de la production de témoignages écrits. Toutefois, comme le pressentait Jean Norton Cru à propos des témoignages français, de nombreux documents dorment encore dans les armoires de la Nouvelle France, et notamment de nombreuses correspondances. À ce premier titre, tous les chercheurs et au-delà, tous les amateurs de documents éclairant l’expérience combattante de la Grande Guerre sauront gré à Michel Litalien de faire découvrir à un large public ces témoignages dont de très nombreux inédits.
Le livre se décompose en deux parties indissociables : la première expose et situe le corpus rassemblé (73 témoignages rassemblés, 51 exploités dans le livre) ; dans la lignée de Témoins de Jean Norton Cru , des tableaux distinguent carnets, souvenirs et correspondances, témoignages du temps de guerre et témoignages tardifs. Les témoignages les plus significatifs font l’objet d’une courte notice situant le témoin et contextualisant la production et parfois la réception première du document. En même temps, bien au fait des réflexions et controverses actuelles concernant les usages et mésusages des témoignages, Michel Litalien attire l’attention de ses lecteurs sur les apports et les biais respectifs de ces différents documents. Enfin, dans des annexes, M. Litalien fournit pour un certain nombre de ses témoins, des fiches biographiques qui complètent utilement cette présentation ainsi que quelques extraits plus longs de témoignages.
Dans sa deuxième partie, l’ouvrage se présente comme un florilège d’extraits organisés selon un déroulement chronologique courant depuis l’enrôlement jusqu’à la démobilisation. Chacun des thèmes est agrémenté d’une courte présentation lançant un certain nombre de pistes de recherches et de réflexion.
• L’enrôlement : M. Litalien souligne le contraste opposant les volontaires anglophones et les volontaires francophones : si les premiers s’enrôlent en grand nombre pour défendre la « mère-patrie » anglaise (la plupart sont nés dans les Iles britanniques), les seconds sont beaucoup moins nombreux et s’enrôlent pour diverses raisons : « secourir la France, par idéalisme, pour le goût d’une aventure lointaine et romantique, ou pour des raisons pécuniaires. De toute façon, pour tous, cette guerre sera finie à Noël, et ne sera qu’une promenade sans risque vers Berlin » (M. Litalien, p. 43).
• Les francophones dans les unités anglophones
• L’entraînement au Canada : le rassemblement, l’habillement et l’entraînement des premières recrues s’effectuent dans une grande improvisation. La préparation militaire durant la première année est des « plus rudimentaires ».
• La traversée : 10 jours environ pour rallier Liverpool. Exercices, loisirs organisés et la messe : « on occupe les soldats ».
• Séjour en Angleterre : poursuite de l’entraînement dans l’attente de l’ultime traversée pour la France. C’est la découverte de l’Angleterre, de sa bière, des Anglais et des Anglaises. Et bien que les liens avec l’ancienne France soient très relâchés, les Canadiens-français commencent à rêver de libérer le sol de leurs ancêtres…
• L’arrivée en France : la surprise et la curiosité des habitants entendant des soldats portant l’uniforme britannique parler français… L’excellence des rapports entre Canadiens-français et Français. La mise à l’abri d’une partie de la solde pour éviter les excès de boisson.
• La vie dans les tranchées : la surprise et la déception des soldats qui découvrent ce qu’est la guerre : « C’était donc ça la guerre !… Nous en avions tous une autre conception. À quoi cela nous servait donc d’avoir été neuf mois entraînés à courir sur les routes et dans les champs, puisque nous étions destinés à être immobiles, à moisir dans ces gouffres, à recommencer notre apprentissage et à devenir des terrassiers » (Claudius Corneloup, 22e bat., p. 105).
• L’expérience du feu : « Quant à l’ennemi, on l’imagine sous les pires traits, on le déteste et on veut le détruire. Toutefois, lorsque ce dernier est fait prisonnier, on est souvent surpris de constater que l’Allemand n’est qu’un humain après tout » (M. Litalien, p. 118).
• Le repos : « contrairement à son officier, le soldat ordinaire n’a pas tous les privilèges dont jouit son supérieur hiérarchique. Alors que l’officier a droit à une permission de dix jours tous les trimestres, le soldat ordinaire, lui, n’a que dix jours par année… » (M. Litalien, p. 136).
• Le temps des fêtes : Noël et le jour de l’an ; les fraternisations de Noël 14 se perpétuent les années suivantes, mais une échelle moindre.
• Loin du foyer : l’importance du lien épistolaire.
• Courcelette, Vimy et autres batailles.
• Les pertes. Les stratégies d’évitement : automutilations ; mutations.
• Les bataillons de renfort : les difficultés à remplir les effectifs de francophones attendus ; le difficile amalgame des francophones et des anglophones. L’impréparation des renforts.
• La conscription : la loi du 28 août 1917 pour pallier le manque de volontaires tant francophones qu’anglophones, même si l’enthousiasme des canadiens-français à l’entrée de la guerre s’est le plus rapidement dissipé. La conscription divise sévèrement le pays. Mais les soldats du front sont majoritairement en faveur du recrutement forcé.
• Indiscipline et exécutions : « pour l’exemple ».
• L’armistice : joie, soulagement et hâte du retour au Canada.
• L’occupation de l’Allemagne.
• La démobilisation : sa lenteur accentuée par les mouvements sociaux dans les ports anglais ; les mutineries du camp de Kimmel (Pays-de-Galles)
Autant de nouvelles pièces importantes à verser au dossier de l’histoire des combattants de la Grande Guerre.
Dans sa conclusion, M. Litalien lance un appel pour une perquisition générale et « citoyenne » des armoires et des greniers ! Souhaitons qu’il soit entendu. C’est certain, au Québec comme ailleurs, d’autres documents précieux attendent leurs découvreurs et leurs historiens. De ce point de vue, comme l’admet d’ailleurs son auteur, cet ouvrage ne constitue qu’un premier jalon dans la découverte et l’exploitation d’un gisement à compléter ; Michel Litalien est bien conscient des limites inhérentes à ce type d’ouvrage mais l’un de ses principaux objectifs consiste précisément à susciter de nouvelles vocations d’historiens ; invoquer l’absence de témoignages francophones ne tient plus. Son livre démontre que la documentation existe et peut se prêter à une exploitation plus ample et plus approfondie pour qui voudrait approcher l’expérience combattante québécoise, la confronter à l’expérience canadienne-anglaise et au-delà, à celle des autres nations engagées. C’est le grand mérite de Michel Litalien.
Frédéric Rousseau