MULLEN John, La chanson populaire en Grande-Bretagne pendant la Grande Guerre (1914-1918), (par F. Bouloc)
Recension :
John MULLEN, La chanson populaire en Grande-Bretagne pendant la Grande Guerre (1914-1918). The Show Must Go On !, Paris, L’Harmattan, 2012, 287 p. (par F. Bouloc)
« Pour un historien, le choix de l’objet de l’étude et des questions auxquelles on cherche à répondre n’est jamais neutre. Nous étudions les chansons populaires pour nous aider à comprendre les gens ordinaires. C’est déjà un certain parti pris de penser que leur histoire est importante, même si, depuis cinquante ans, la conception de l’histoire vue d’en-bas a gagné énormément de terrain » (p. 12)
Cette déclaration liminaire de principe situe d’emblée l’ouvrage de John Mullen, qui est tout sauf un travail de mémorialiste nostalgique. Enseignant à l’Université de Paris-Est Créteil, l’auteur témoigne certes tout au long de ce livre d’une connaissance fine et d’un goût personnel pour les chansons qui constituent son objet d’étude et, plus largement, pour la musique populaire sous toutes ses formes et à toutes les époques. Mais le connaisseur sait s’extraire du piège de l’érudition livrée à elle-même. Sa culture personnelle est toujours mise au service de problématiques pertinentes et surtout, ainsi que le montre la citation ci-dessus, explicitement posées.
Ce livre est une analyse à plusieurs focales des chansons populaires britanniques depuis le XIXe siècle jusqu’à l’entre-deux-guerres, avec évidemment un éclairage spécifique et conséquent de la période du premier conflit mondial. La réflexion est dense, les entrées multiples. Le sujet choisi pourrait être traité de façon simpliste : qu’écoutent et chantent les ouvriers et employés britanniques le samedi soir au music-hall, quels sont les thèmes les plus populaires parmi ceux qui sont abordés… Or, si John Mullen se livre à une étude approfondie, quantitative et qualitative, de son corpus, il ne s’y limite pas.
La première partie du livre est ainsi consacrée à une mise en perspective historique et sociologique, qui cerne les enjeux : qui sont les adeptes de ces formes culturelles, quelles sont les pratiques afférentes, quelles structures, symboliques, morales, économiques, régissent le champ ainsi délimité ? On découvre par suite que la musique populaire, définie « tout simplement comme les chansons les plus connues et les plus chantées à l’époque » (p. 13), est en Angleterre au début du XXe siècle intimement liée à l’urbanisation du pays. Les lieux et formes de divertissement (salles de danse, chorales et fanfares, chant dans le cadre privé) se placent dans un cadre urbain, de même que la vente massive des partitions des airs les plus appréciés : le pays compte un piano pour quinze habitants en 1914 (p. 18)… Sans oublier les revues, genre mêlant le chant, la musique et les danseuses dont le succès ne fait que croître dans la période.
La chanson populaire, dans ce cadre, doit aussi être rentable pour les producteurs et les tenanciers d’établissement : cette pression, propre à la culture non académique en général, influe sur les contenus et les choix artistiques. Ce qui n’est pas susceptible de plaire n’a, en théorie, pas vocation à être présenté – d’où la tension entre autour de la question des goûts du public, selon que l’on considère qu’ils façonnent la production culturelle ou sont modelés par celle-ci. Mullen critique ici les analyses classiques d’Adorno sur l’abêtissement des masses, en replaçant les productions culturelles de chaque époque dans leur contexte économique, social et technologique ; on touche là, plus largement, à la formation des opinions ou sensibilités collectives. L’auteur rappelle que si la période étudiée compte de véritables “stars” (auxquelles plusieurs encarts illustrés sont judicieusement consacrés), celles-ci ne sont pas considérées par leurs contemporains comme des porte-parole contestaires, des « poètes / prophètes » tels que le rock en recèle, mais bien davantage comme des pairs qui en s’ouvrant et se confiant, se placent en sympathie avec les auditeurs (p. 112).
L’Anglais moyen amateur des divertissements du music-hall n’est d’ailleurs pas si moutonnier que cela, puisque s’y adonner implique de passer outre un certain nombre de préventions, venues de milieux très divers. Les élites bourgeoises et intellectuelles, les cercles moralistes sont les premiers, et inévitables, pourfendeurs de formes culturelles forcément jugées rabaissantes et licencieuses, mais ils ne sont pas les seuls. Les milieux progressistes et socialistes ne sont pas en reste, avec une critique fondée sur la nécessaire « amélioration du niveau culturel de l’ouvrier » (p. 45) sans vraiment trancher entre la seule légitimation de la culture savante et académique, ou la création d’une « culture proprement ouvrière indépendante des intérêts commerciaux (ou tout au moins une culture socialiste militante) » (p. 45). Le consensus s’établit alors autour des « loisirs rationnels », visant à étancher la soif de loisirs mais en prenant soin de la guider, au risque de la condescendance ainsi que d’une certaine aseptisation. Cette démarche n’a pas rencontré un franc succès, du fait de la concurrence d’une véritable industrie du divertissement, et aussi peut-être d’un trait intemporel de la culture populaire, qui est celui de la méfiance instinctive et volontiers railleuse contre tout ce qui s’apparente à l’élitisme, l’autorité où les rapports sociaux sont décelés. L’auteur se réfère ici, par exemple, aux analyses de Richard Hoggart, mais cette propension populaire à désacraliser ce qui vient d’en-haut renvoie aussi aux travaux de Mikhaïl Bakhtine sur la culture populaire au XVIe siècle[1].
Qu’écoute-t-on, que chante-t-on pendant la guerre ? Chaque aspect de la réponse à ces questions est abordé sous forme de parties thématiques, soutenues en fin d’ouvrage par une chronologie fine, une liste des titres du répertoire et le cas échéant, des liens pour aller écouter les chansons en question. De fait, le conflit se traduit dans ce domaine par une adaptation du répertoire aux circonstances. Les thèmes abordés ne sont pas radicalement modifiés, mais, en un processus créatif et culturel très significatif, mis au goût du jour. Voici quelques titres des années de guerre qui donnent le ton de la production : On est tous contents quand il y a du soleil (1914), Maintenant que les temps sont durs (1915), Ce sont les gars en kaki qui prennent les filles bien (1915), Le premier jour qu’il est venu en permission (1916), Bon sang, je n’arrive pas à fermer le dernier bouton ! (1916), Quand Mamie était jeune, on ne dansait pas le fox-trot (1917)… Les identités locales, souvent célébrées, sont reliées aux pal battalions, les régiments de volontaires à recrutement locaux. La place des femmes, souvent chantée avec une certaine misogynie, évolue dans les chansons en même temps que dans la société et l’effort de guerre : Kitty, la fille du téléphone (1914), Le club de football féminin (1915), Si les fi-filles pouvaient devenir soldats (1915),….
Dans le corpus étudié (912 chansons), la vie dans la guerre et l’amour se taillent la part du lion (41 % pour ces deux catégories réunies). Inversement, il faut noter le peu de succès de sujets comme l’Empire ou l’antigermanisme : rapporté aux contraintes déjà précisées sur la programmation des music-halls, ciblée sur “ce qui marche”, cet élément dit beaucoup sur la superficialité de l’empreinte de la culture dominante. Et, inversement, précise l’auteur, « la structure économique du music-hall ne laisse pas facilement s’exprimer la contestation. Ce qui signifie que lorsque des chansons contestataires réussissent à percer, nous pouvons être sûrs qu’elles représentent une opinion publique puissante » (p. 204, exemples dans les pages suivantes). Les chansons portant sur la guerre, passé le patriotisme populaire des premiers temps, se focalisent sur la nostalgie du foyer, de la bien-aimée, de la famille, du pays natal… Cette nostalgie de la vie civile, propice aux rêveries sur la fin de la guerre, est fréquemment rencontrée dans les témoignages de combattants, s’exprime dans le couplet suivant, daté de 1917 : « Nous ne voulons pas voir de drapeaux partout quand nous revenons de la guerre ! Nous ne voulons pas de vos grandes fanfares, nous ne voulons pas de vos beaux discours (…) Mais nous voulons retrouver enfin les femmes que nous avons laissées à la maison ! » (p. 206)
Sans puiser davantage dans la riche matière de cet ouvrage, on ne peut pour terminer qu’en souligner l’intérêt, et la portée bien plus large que le sujet traité. Cette qualité est peut-être inhérente au genre musical lui-même, la chanson populaire transcendant aisément les générations et même les frontières : on songe par exemple à la très belle scène du film Das Boot de Wolfgang Petersen (1981) dans laquelle des sous-mariniers allemands de 1941, au moral vacillant, reprennent tous en chœur la chanson It’s a long way to Tipperary, datée de 1913 et devenue un grand succès dès août 1914…
[1] Mikhaïl BAKHTINE, L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen-Âge et sous la Renaissance, Paris, Gallimard, « Tel », 2006, [1970], 471 p.
Recension :
John MULLEN, La chanson populaire en Grande-Bretagne pendant la Grande Guerre (1914-1918). The Show Must Go On !, Paris, L’Harmattan, 2012, 287 p. (par F. Bouloc)
« Pour un historien, le choix de l’objet de l’étude et des questions auxquelles on cherche à répondre n’est jamais neutre. Nous étudions les chansons populaires pour nous aider à comprendre les gens ordinaires. C’est déjà un certain parti pris de penser que leur histoire est importante, même si, depuis cinquante ans, la conception de l’histoire vue d’en-bas a gagné énormément de terrain » (p. 12)
Cette déclaration liminaire de principe situe d’emblée l’ouvrage de John Mullen, qui est tout sauf un travail de mémorialiste nostalgique. Enseignant à l’Université de Paris-Est Créteil, l’auteur témoigne certes tout au long de ce livre d’une connaissance fine et d’un goût personnel pour les chansons qui constituent son objet d’étude et, plus largement, pour la musique populaire sous toutes ses formes et à toutes les époques. Mais le connaisseur sait s’extraire du piège de l’érudition livrée à elle-même. Sa culture personnelle est toujours mise au service de problématiques pertinentes et surtout, ainsi que le montre la citation ci-dessus, explicitement posées.
Ce livre est une analyse à plusieurs focales des chansons populaires britanniques depuis le XIXe siècle jusqu’à l’entre-deux-guerres, avec évidemment un éclairage spécifique et conséquent de la période du premier conflit mondial. La réflexion est dense, les entrées multiples. Le sujet choisi pourrait être traité de façon simpliste : qu’écoutent et chantent les ouvriers et employés britanniques le samedi soir au music-hall, quels sont les thèmes les plus populaires parmi ceux qui sont abordés… Or, si John Mullen se livre à une étude approfondie, quantitative et qualitative, de son corpus, il ne s’y limite pas.
La première partie du livre est ainsi consacrée à une mise en perspective historique et sociologique, qui cerne les enjeux : qui sont les adeptes de ces formes culturelles, quelles sont les pratiques afférentes, quelles structures, symboliques, morales, économiques, régissent le champ ainsi délimité ? On découvre par suite que la musique populaire, définie « tout simplement comme les chansons les plus connues et les plus chantées à l’époque » (p. 13), est en Angleterre au début du XXe siècle intimement liée à l’urbanisation du pays. Les lieux et formes de divertissement (salles de danse, chorales et fanfares, chant dans le cadre privé) se placent dans un cadre urbain, de même que la vente massive des partitions des airs les plus appréciés : le pays compte un piano pour quinze habitants en 1914 (p. 18)… Sans oublier les revues, genre mêlant le chant, la musique et les danseuses dont le succès ne fait que croître dans la période.
La chanson populaire, dans ce cadre, doit aussi être rentable pour les producteurs et les tenanciers d’établissement : cette pression, propre à la culture non académique en général, influe sur les contenus et les choix artistiques. Ce qui n’est pas susceptible de plaire n’a, en théorie, pas vocation à être présenté – d’où la tension entre autour de la question des goûts du public, selon que l’on considère qu’ils façonnent la production culturelle ou sont modelés par celle-ci. Mullen critique ici les analyses classiques d’Adorno sur l’abêtissement des masses, en replaçant les productions culturelles de chaque époque dans leur contexte économique, social et technologique ; on touche là, plus largement, à la formation des opinions ou sensibilités collectives. L’auteur rappelle que si la période étudiée compte de véritables “stars” (auxquelles plusieurs encarts illustrés sont judicieusement consacrés), celles-ci ne sont pas considérées par leurs contemporains comme des porte-parole contestaires, des « poètes / prophètes » tels que le rock en recèle, mais bien davantage comme des pairs qui en s’ouvrant et se confiant, se placent en sympathie avec les auditeurs (p. 112).
L’Anglais moyen amateur des divertissements du music-hall n’est d’ailleurs pas si moutonnier que cela, puisque s’y adonner implique de passer outre un certain nombre de préventions, venues de milieux très divers. Les élites bourgeoises et intellectuelles, les cercles moralistes sont les premiers, et inévitables, pourfendeurs de formes culturelles forcément jugées rabaissantes et licencieuses, mais ils ne sont pas les seuls. Les milieux progressistes et socialistes ne sont pas en reste, avec une critique fondée sur la nécessaire « amélioration du niveau culturel de l’ouvrier » (p. 45) sans vraiment trancher entre la seule légitimation de la culture savante et académique, ou la création d’une « culture proprement ouvrière indépendante des intérêts commerciaux (ou tout au moins une culture socialiste militante) » (p. 45). Le consensus s’établit alors autour des « loisirs rationnels », visant à étancher la soif de loisirs mais en prenant soin de la guider, au risque de la condescendance ainsi que d’une certaine aseptisation. Cette démarche n’a pas rencontré un franc succès, du fait de la concurrence d’une véritable industrie du divertissement, et aussi peut-être d’un trait intemporel de la culture populaire, qui est celui de la méfiance instinctive et volontiers railleuse contre tout ce qui s’apparente à l’élitisme, l’autorité où les rapports sociaux sont décelés. L’auteur se réfère ici, par exemple, aux analyses de Richard Hoggart, mais cette propension populaire à désacraliser ce qui vient d’en-haut renvoie aussi aux travaux de Mikhaïl Bakhtine sur la culture populaire au XVIe siècle[1].
Qu’écoute-t-on, que chante-t-on pendant la guerre ? Chaque aspect de la réponse à ces questions est abordé sous forme de parties thématiques, soutenues en fin d’ouvrage par une chronologie fine, une liste des titres du répertoire et le cas échéant, des liens pour aller écouter les chansons en question. De fait, le conflit se traduit dans ce domaine par une adaptation du répertoire aux circonstances. Les thèmes abordés ne sont pas radicalement modifiés, mais, en un processus créatif et culturel très significatif, mis au goût du jour. Voici quelques titres des années de guerre qui donnent le ton de la production : On est tous contents quand il y a du soleil (1914), Maintenant que les temps sont durs (1915), Ce sont les gars en kaki qui prennent les filles bien (1915), Le premier jour qu’il est venu en permission (1916), Bon sang, je n’arrive pas à fermer le dernier bouton ! (1916), Quand Mamie était jeune, on ne dansait pas le fox-trot (1917)… Les identités locales, souvent célébrées, sont reliées aux pal battalions, les régiments de volontaires à recrutement locaux. La place des femmes, souvent chantée avec une certaine misogynie, évolue dans les chansons en même temps que dans la société et l’effort de guerre : Kitty, la fille du téléphone (1914), Le club de football féminin (1915), Si les fi-filles pouvaient devenir soldats (1915),….
Dans le corpus étudié (912 chansons), la vie dans la guerre et l’amour se taillent la part du lion (41 % pour ces deux catégories réunies). Inversement, il faut noter le peu de succès de sujets comme l’Empire ou l’antigermanisme : rapporté aux contraintes déjà précisées sur la programmation des music-halls, ciblée sur “ce qui marche”, cet élément dit beaucoup sur la superficialité de l’empreinte de la culture dominante. Et, inversement, précise l’auteur, « la structure économique du music-hall ne laisse pas facilement s’exprimer la contestation. Ce qui signifie que lorsque des chansons contestataires réussissent à percer, nous pouvons être sûrs qu’elles représentent une opinion publique puissante » (p. 204, exemples dans les pages suivantes). Les chansons portant sur la guerre, passé le patriotisme populaire des premiers temps, se focalisent sur la nostalgie du foyer, de la bien-aimée, de la famille, du pays natal… Cette nostalgie de la vie civile, propice aux rêveries sur la fin de la guerre, est fréquemment rencontrée dans les témoignages de combattants, s’exprime dans le couplet suivant, daté de 1917 : « Nous ne voulons pas voir de drapeaux partout quand nous revenons de la guerre ! Nous ne voulons pas de vos grandes fanfares, nous ne voulons pas de vos beaux discours (…) Mais nous voulons retrouver enfin les femmes que nous avons laissées à la maison ! » (p. 206)
Sans puiser davantage dans la riche matière de cet ouvrage, on ne peut pour terminer qu’en souligner l’intérêt, et la portée bien plus large que le sujet traité. Cette qualité est peut-être inhérente au genre musical lui-même, la chanson populaire transcendant aisément les générations et même les frontières : on songe par exemple à la très belle scène du film Das Boot de Wolfgang Petersen (1981) dans laquelle des sous-mariniers allemands de 1941, au moral vacillant, reprennent tous en chœur la chanson It’s a long way to Tipperary, datée de 1913 et devenue un grand succès dès août 1914…
[1] Mikhaïl BAKHTINE, L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen-Âge et sous la Renaissance, Paris, Gallimard, « Tel », 2006, [1970], 471 p.
Recension :
John MULLEN, La chanson populaire en Grande-Bretagne pendant la Grande Guerre (1914-1918). The Show Must Go On !, Paris, L’Harmattan, 2012, 287 p. (par F. Bouloc)
« Pour un historien, le choix de l’objet de l’étude et des questions auxquelles on cherche à répondre n’est jamais neutre. Nous étudions les chansons populaires pour nous aider à comprendre les gens ordinaires. C’est déjà un certain parti pris de penser que leur histoire est importante, même si, depuis cinquante ans, la conception de l’histoire vue d’en-bas a gagné énormément de terrain » (p. 12)
Cette déclaration liminaire de principe situe d’emblée l’ouvrage de John Mullen, qui est tout sauf un travail de mémorialiste nostalgique. Enseignant à l’Université de Paris-Est Créteil, l’auteur témoigne certes tout au long de ce livre d’une connaissance fine et d’un goût personnel pour les chansons qui constituent son objet d’étude et, plus largement, pour la musique populaire sous toutes ses formes et à toutes les époques. Mais le connaisseur sait s’extraire du piège de l’érudition livrée à elle-même. Sa culture personnelle est toujours mise au service de problématiques pertinentes et surtout, ainsi que le montre la citation ci-dessus, explicitement posées.
Ce livre est une analyse à plusieurs focales des chansons populaires britanniques depuis le XIXe siècle jusqu’à l’entre-deux-guerres, avec évidemment un éclairage spécifique et conséquent de la période du premier conflit mondial. La réflexion est dense, les entrées multiples. Le sujet choisi pourrait être traité de façon simpliste : qu’écoutent et chantent les ouvriers et employés britanniques le samedi soir au music-hall, quels sont les thèmes les plus populaires parmi ceux qui sont abordés… Or, si John Mullen se livre à une étude approfondie, quantitative et qualitative, de son corpus, il ne s’y limite pas.
La première partie du livre est ainsi consacrée à une mise en perspective historique et sociologique, qui cerne les enjeux : qui sont les adeptes de ces formes culturelles, quelles sont les pratiques afférentes, quelles structures, symboliques, morales, économiques, régissent le champ ainsi délimité ? On découvre par suite que la musique populaire, définie « tout simplement comme les chansons les plus connues et les plus chantées à l’époque » (p. 13), est en Angleterre au début du XXe siècle intimement liée à l’urbanisation du pays. Les lieux et formes de divertissement (salles de danse, chorales et fanfares, chant dans le cadre privé) se placent dans un cadre urbain, de même que la vente massive des partitions des airs les plus appréciés : le pays compte un piano pour quinze habitants en 1914 (p. 18)… Sans oublier les revues, genre mêlant le chant, la musique et les danseuses dont le succès ne fait que croître dans la période.
La chanson populaire, dans ce cadre, doit aussi être rentable pour les producteurs et les tenanciers d’établissement : cette pression, propre à la culture non académique en général, influe sur les contenus et les choix artistiques. Ce qui n’est pas susceptible de plaire n’a, en théorie, pas vocation à être présenté – d’où la tension entre autour de la question des goûts du public, selon que l’on considère qu’ils façonnent la production culturelle ou sont modelés par celle-ci. Mullen critique ici les analyses classiques d’Adorno sur l’abêtissement des masses, en replaçant les productions culturelles de chaque époque dans leur contexte économique, social et technologique ; on touche là, plus largement, à la formation des opinions ou sensibilités collectives. L’auteur rappelle que si la période étudiée compte de véritables “stars” (auxquelles plusieurs encarts illustrés sont judicieusement consacrés), celles-ci ne sont pas considérées par leurs contemporains comme des porte-parole contestaires, des « poètes / prophètes » tels que le rock en recèle, mais bien davantage comme des pairs qui en s’ouvrant et se confiant, se placent en sympathie avec les auditeurs (p. 112).
L’Anglais moyen amateur des divertissements du music-hall n’est d’ailleurs pas si moutonnier que cela, puisque s’y adonner implique de passer outre un certain nombre de préventions, venues de milieux très divers. Les élites bourgeoises et intellectuelles, les cercles moralistes sont les premiers, et inévitables, pourfendeurs de formes culturelles forcément jugées rabaissantes et licencieuses, mais ils ne sont pas les seuls. Les milieux progressistes et socialistes ne sont pas en reste, avec une critique fondée sur la nécessaire « amélioration du niveau culturel de l’ouvrier » (p. 45) sans vraiment trancher entre la seule légitimation de la culture savante et académique, ou la création d’une « culture proprement ouvrière indépendante des intérêts commerciaux (ou tout au moins une culture socialiste militante) » (p. 45). Le consensus s’établit alors autour des « loisirs rationnels », visant à étancher la soif de loisirs mais en prenant soin de la guider, au risque de la condescendance ainsi que d’une certaine aseptisation. Cette démarche n’a pas rencontré un franc succès, du fait de la concurrence d’une véritable industrie du divertissement, et aussi peut-être d’un trait intemporel de la culture populaire, qui est celui de la méfiance instinctive et volontiers railleuse contre tout ce qui s’apparente à l’élitisme, l’autorité où les rapports sociaux sont décelés. L’auteur se réfère ici, par exemple, aux analyses de Richard Hoggart, mais cette propension populaire à désacraliser ce qui vient d’en-haut renvoie aussi aux travaux de Mikhaïl Bakhtine sur la culture populaire au XVIe siècle[1].
Qu’écoute-t-on, que chante-t-on pendant la guerre ? Chaque aspect de la réponse à ces questions est abordé sous forme de parties thématiques, soutenues en fin d’ouvrage par une chronologie fine, une liste des titres du répertoire et le cas échéant, des liens pour aller écouter les chansons en question. De fait, le conflit se traduit dans ce domaine par une adaptation du répertoire aux circonstances. Les thèmes abordés ne sont pas radicalement modifiés, mais, en un processus créatif et culturel très significatif, mis au goût du jour. Voici quelques titres des années de guerre qui donnent le ton de la production : On est tous contents quand il y a du soleil (1914), Maintenant que les temps sont durs (1915), Ce sont les gars en kaki qui prennent les filles bien (1915), Le premier jour qu’il est venu en permission (1916), Bon sang, je n’arrive pas à fermer le dernier bouton ! (1916), Quand Mamie était jeune, on ne dansait pas le fox-trot (1917)… Les identités locales, souvent célébrées, sont reliées aux pal battalions, les régiments de volontaires à recrutement locaux. La place des femmes, souvent chantée avec une certaine misogynie, évolue dans les chansons en même temps que dans la société et l’effort de guerre : Kitty, la fille du téléphone (1914), Le club de football féminin (1915), Si les fi-filles pouvaient devenir soldats (1915),….
Dans le corpus étudié (912 chansons), la vie dans la guerre et l’amour se taillent la part du lion (41 % pour ces deux catégories réunies). Inversement, il faut noter le peu de succès de sujets comme l’Empire ou l’antigermanisme : rapporté aux contraintes déjà précisées sur la programmation des music-halls, ciblée sur “ce qui marche”, cet élément dit beaucoup sur la superficialité de l’empreinte de la culture dominante. Et, inversement, précise l’auteur, « la structure économique du music-hall ne laisse pas facilement s’exprimer la contestation. Ce qui signifie que lorsque des chansons contestataires réussissent à percer, nous pouvons être sûrs qu’elles représentent une opinion publique puissante » (p. 204, exemples dans les pages suivantes). Les chansons portant sur la guerre, passé le patriotisme populaire des premiers temps, se focalisent sur la nostalgie du foyer, de la bien-aimée, de la famille, du pays natal… Cette nostalgie de la vie civile, propice aux rêveries sur la fin de la guerre, est fréquemment rencontrée dans les témoignages de combattants, s’exprime dans le couplet suivant, daté de 1917 : « Nous ne voulons pas voir de drapeaux partout quand nous revenons de la guerre ! Nous ne voulons pas de vos grandes fanfares, nous ne voulons pas de vos beaux discours (…) Mais nous voulons retrouver enfin les femmes que nous avons laissées à la maison ! » (p. 206)
Sans puiser davantage dans la riche matière de cet ouvrage, on ne peut pour terminer qu’en souligner l’intérêt, et la portée bien plus large que le sujet traité. Cette qualité est peut-être inhérente au genre musical lui-même, la chanson populaire transcendant aisément les générations et même les frontières : on songe par exemple à la très belle scène du film Das Boot de Wolfgang Petersen (1981) dans laquelle des sous-mariniers allemands de 1941, au moral vacillant, reprennent tous en chœur la chanson It’s a long way to Tipperary, datée de 1913 et devenue un grand succès dès août 1914…
[1] Mikhaïl BAKHTINE, L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen-Âge et sous la Renaissance, Paris, Gallimard, « Tel », 2006, [1970], 471 p.

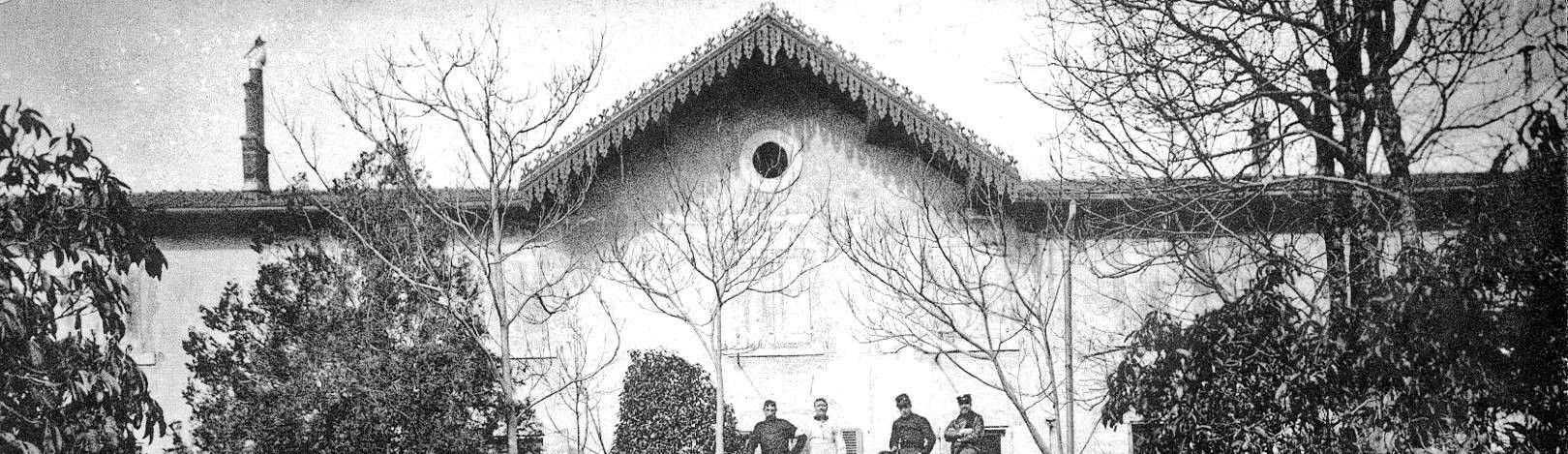
Les commentaires