ROYNETTE Odile, Les mots des tranchées, Paris, Armand Colin, 2010, 286 p. (par Alexandre Lafon)
A-t-il existé une « langue des tranchées » ?
Les mots sont des armes[1]. Et il est heureux de profiter de l’érudition d’Odile Roynette qui s’applique sur cette question à comprendre la genèse et les fonctions prises par ce que l’on nomme la « langue combattante » dite aussi « langue poilue » durant la Grande Guerre. Cette dernière fut mise en valeur par différents lettrés et médias contemporains et utilisée à la fois comme outil de mobilisation, d’études et de récupération esthétique. Mais au-delà, travailler sur cette « langue de guerre » permet aussi, souligne l’auteur, de cerner « de plus près l’ethos combattant » et ainsi approfondir la connaissance des expériences de guerre vécues par les acteurs combattants. L’entreprise, fondée entre autres sur les travaux de linguistique de Pierre Bourdieu, a le mérite d’explorer avec finesse la genèse et la cristallisation du vocabulaire de guerre. Dire, nommer, c’est construire effectivement de l’identité, s’approprier la guerre et dénoncer l’ennemi. Le premier conflit mondial apparaît de ce point de vue comme un laboratoire de la diffusion d’un lexique cantonné avant 1914 dans le domaine de l’argot militaire et devenu pour certains durant le conflit le vecteur de la création d’une langue nationale. Ainsi, la Grande Guerre se serait jouée aussi sur le terrain linguistique.
Un apport certain sur le terrain de la compréhension du lexique combattant
L’ouvrage divisé en six chapitres commence par une étude de la diffusion dans l’espace public de la notion de « langue poilue », mise en lumière dès 1915 dans les journaux de tranchées, puis par certains auteurs combattants à travers lexiques et articles publiés dans la presse grand public. La langue semble alors devenir un enjeu identitaire national. Le second et le troisième chapitres dévoilent le rôle joué par les spécialistes des sciences du langage et les écrivains-combattants qui s’emparent de ce « front de la langue » : les linguistes Albert Dauzat et Gaston Esnault, tout deux soldats, s’emploient en effet à étudier ce qui, dans un premier temps, a été rejeté comme un non-objet linguistique : l’argot des tranchées. Pour les deux protagonistes, il existe bien un « argot poilue », forgée dans la guerre à partir de l’apport de plusieurs sources : langue populaire, argot parisien, langues régionales. Ainsi, « la guerre met en lumière des manières de parler qui ne sont pas propres aux soldats, mais que l’expérience combattante modèle en profondeur et transforme. La « langue poilue », c’est la langue de la nation en guerre et pas seulement celle de l’armée (…) », souligne Odile Roynette à propos des conclusions de Gaston Esnault. Henri Barbusse ou Roland Dorgelès ne s’y sont pas trompés en utilisant le lexique argotique parlé qu’ils ont relevé lors de leur séjour au front et dont ils font un abondant « usage littéraire ». Le critique de témoignage Jean Norton Cru a d’ailleurs reproché à Barbusse cet usage qui ne correspondait pas, selon lui, à la réalité du parler des tranchées[2], sans comprendre au dire d’Odile Roynette, en quoi Barbusse écrit un roman sur « le ravage du consentement » à la guerre (p. 90).
La Grande Guerre hérite comme le souligne bien l’auteur dans le chapitre 4, de différentes strates historiques et linguistiques en termes de vocabulaire. Elle réactive l’intérêt des chercheurs contemporains de la guerre pour la « langue verte » dans le cadre de la structuration de la « nation linguistique » (p. 130). L’argot militaire s’avère ainsi un substrat important et Odile Roynette montre à la fois son évolution lexicale, et l’affirmation sociale de ce parler comme témoignage de la place prise par l’armée dans la Nation. Cette contextualisation fine montre combien la conscription a transformé le dire militaire (p. 120 par exemple), et imposé des codes linguistiques que la guerre remodèle un peu plus dans le contexte d’une mobilisation nationale. Ainsi, les mots des tranchées empruntent au monde militaire et à ses métaphores fertiles, depuis celles de la caserne jusqu’à celles plus exotique de l’expérience coloniale. Ils intègrent effectivement dans cette genèse l’argot parisien et quelques tournures héritées des régiments provinciaux. Il s’agit alors par exemple pour les locuteurs, à travers des tournures humoristiques et/ou métaphoriques, de dévaluer le grade, d’atténuer l’imposition du pouvoir symbolique et physique. Le vocabulaire s’enrichit également dans la guerre de néologismes inspirés par les conditions du combats que ce soit en rapport aux armes employées, aux formes du combat et à l’importance des sens dans l’environnement combattant (apparition du terme « roquet » pour désigner par exemple le canon de 75 mm français). On y apprend ainsi une foule de renseignements sur l’origine de tels ou tels mots ou expressions comme « pousse-caillou », « ramdam » ou « avoir les colombins ». On perçoit la subtilité des mécanismes linguistiques qui en marquent les transformations de sens durant la guerre, comme le glissement de l’utilisation du mot « as » de la cavalerie à l’aviation, ou celui du mot « bousiller » encore utilisé aujourd’hui. Odile Roynette souligne ainsi la malléabilité de la langue de guerre qu’elle cherche à circonscrire, et qu’elle explore de manière extrêmement intéressante le même processus du côté de l’allemand et de l’anglais, et ce dans une plage chronologique permettant de replacer dans ce domaine et à sa juste place l’événement Grande Guerre.
Le chapitre 5 s’applique à rechercher dans les « paroles combattantes », au plus près du « dit » des soldats, cette appropriation linguistique. En cela, les combattants n’ont pas fait œuvre d’originalité, comme le suggère l’auteur, qui voit dans la formation de ce lexique un savoir-faire langagier hérité. Et si les combattantes enrichissent encore le vocabulaire de l’oralité populaire, c’est essentiellement pour s’approprier la guerre, « garder prise » sur les changements opérés dans leur vie, donner sens à « l’expérience sensible », « reconquérir une part de liberté » et se forger une identité de groupe. En ce sens, l’auteur fait heureusement référence à l’utilisation du mot « poilu » dont elle souligne qu’il fut davantage usité qu’on ne l’a écrit par les combattants eux-mêmes (p. 214). Effectivement, les témoignages écrits combattants le confirment : il ne fut pas seulement un mot de l’arrière.
Au final, nombre d’expressions et métaphores liées aux formes prises par la guerre moderne (« front », « mobilisation », « tranchée ») intègrent rapidement le cœur de la société civile. Dans le dernier chapitre, Odile Roynette tente d’interroger le degré de pénétration de cette « langue poilue » dans la sphère sociale et son imaginaire, en s’appuyant sur plusieurs exemples empruntés à la correspondance, aux discours de Clemenceau, à l’étude des journaux à travers le prisme de l’étude du grammairien Georges Prévot datée de 1918. Ce processus de diffusion, nous dit l’auteur, a pour corollaire d’« exprimer la place désormais acquise par la guerre dans l’espace social ».
Une dimension sociale pourtant minimisée
Au regard de cette problématique forte intéressante, plusieurs réserves nous semblent pourtant importantes à souligner quant à l’approche choisies pour cette étude des « mots des tranchées ». Odile Roynette ne se trompe pas en en faisant l’objet d’une enquête poussée. Plus que pour d’autres conflits, les mots ont été mobilisés, et en premier lieu dans un discours légitime et massivement diffusé pour dire le combat et la capacité des combattants à s’adapter et à « consentir » à leur devoir. Mais le danger pour l’historien est bien de glisser de la perception du discours dominant et des représentations vers les pratiques réelles et au final, l’affirmation de la réalité d’une « langue poilue » générique.
L’auteur souligne pourtant à plusieurs reprises le danger de ne percevoir ce langage, s’il existe, qu’à travers le prisme des auteurs qui s’y sont intéressés. Ainsi, sur la question linguistique appliquée au Feu de Barbusse, l’auteur veut voir dans l’abondance des dialogues empruntant à l’argot militaire, un moyen de conjurer la peur, de donner à lire la transformation de l’homme en combattant, un témoignage de la violence des combats qui impacte les formes de la communication. Derrière se dévoilerait l’existence de la « culture de guerre », laissée au singulier, et l’ensauvagement des hommes. Pourtant, la confrontation de la correspondance de l’écrivain Barbusse avec son œuvre offre une autre lecture, celle d’un romancier mu par la volonté de témoigner de la guerre, certes, mais aussi de sa rencontre avec le « peuple », tout comme de sa volonté de montrer que la guerre, arrivée à ce point, doit se terminer et qu’il faut aller jusqu’au bout. A aucun moment, sauf au détour de quelques fins de phrases, Odile Roynette ne met en perspective l’identité sociale de Barbusse, de Dorgelès ou d’Arnoux. Pourtant, derrière le langage cru se cache le désir d’œuvres esthétiques s’appuyant sur cette curiosité vis-à-vis des masses rencontrées dans les tranchées, et ce souci de rendre légitime un langage combattant qui affirme l’existence d’un véritable groupe. Il y a la confrontation entre des hommes issus de la bourgeoisie et la « masse » dans le quotidien de la guerre, le souci de montrer le partage d’une même vie, ou en tout cas, la rencontre de la nation en guerre.
Plus généralement, comme le souligne l’auteur, les pratiques langagières transparaissent à travers « les enquêtes menées par des lettrés » (p. 188). Albert Dauzat ou Gaston Esnault font du langage un objet d’étude ethnologique. Il en va de même finalement d’Henri Barbusse. Ainsi, effectivement la langue passe par le filtre des chercheurs qui s’y intéressent, des lettrés qui la relèvent, les écrivains qui en font leur support d’écriture. C’est pour cette raison qu’il nous semble important de ne pas faire de la langue parlée autre chose qu’une appropriation du vécu, et un formidable terrain de circulation des mots. « Il convient de d’être particulièrement attentif à ce geste anodin qui, en créant un lien entre le dehors et le dedans autorisé par l’ouverture de la bouche, permet d’éprouver sa présence au monde » (p. 199), écrit l’auteur. Il paraît plus juste, à mon sens, d’insister sur l’importance prise par ces « temps » sociaux de communication, de partage que sont les repas, tous pris en commun, entre hommes, en différenciant justement les groupes qui les composent, et donc les mots qui circulent.
Mais Odile Roynette elle-même, en évoquant les « hommes dépourvus de capital culturel », se place elle-même dans une position de jugement et une position culturelle dominante. Elle ne s’appuie donc que sur des sources issues de cette culture dominante. A ce titre, les journaux de tranchées ou la correspondance de l’agrégé Jules Isaac avec sa femme peintre Laure sont-il réellement des sources judicieuses pour prendre la mesure du sens donné (ou non) par l’ensemble des locuteurs aux « mots des tranchées » ? Le risque est bien de délimiter, normer un processus ou des usages à partir d’une seule catégorie sociale. A trop s’appuyer sur les travaux de Gaston Esnault, dont les correspondants sont issus de la même catégorie sociale ou presque, on oublie peut-être le regard socialement marquée sur ce qui est appelé par les linguistes argot, langue verte ou langue de guerre. Il manque donc la profondeur sociale nécessaire, et l’exploration de « l’usage différent » (p. 181) des mots et du sens qu’ils peuvent prendre. D’autant qu’Odile Roynette doute de l’existence réelle d’une « langue poilue » dans un passage qui nous paraît essentiel à propos de l’œuvre de Maurice Genevoix, Sous Verdun : « A lui [Maurice Genevoix], comme à nous, s’impose ainsi l’évidence que l’expérience de la guerre ne traverse pas de la même manière la parole des combattants et qu’elle laisse subsister d’importantes différences. En sorte qu’il n’existerait pas une « langue poilue », mais une infinité d’usages, difficilement saisissables » (p. 99). Pourquoi dès lors, ne pas avoir creusé ce riche sillon ?
Seuls les termes propres à soutenir la démonstration sont décortiqués. L’acronyme PCDF (« pauvre couillon du front ») par exemple, et tous les mots mettant à mal l’autorité (sobriquets et autres jeux de mots) auraient mérité à notre sens une plus juste place dans cette étude qui se veut inscrite dans l’étude des enjeux de pouvoir dans l’économie des échanges linguistiques. Ainsi, n’aurait-il pas fallu approfondir la question de l’opposition par le langage à l’autorité officielle (p. 193) ?
Un système de « penser la guerre » étouffant
Décidément, le corps de l’ennemi et la manière de le nommé est à la mode dans certains récents ouvrages portant sur la Grande Guerre.
De nombreuses études ont pourtant montrées de manière assez convainquante, la complexité du regard que les combattants français en particulier, mais c’est aussi valable du côté allemand ou britannique, pouvaient porter, sur le champ de bataille au « contact » avec leurs adversaires. Il ne se limite en aucun cas à une animalisation. Dans le même ordre d’idée et plus généralement, doit-on faire de l’utilisation des mots du « corps », là encore, un phénomène qui laisse entrevoir violence et brutalisation ? Faut-il être uniquement combattant pour utiliser des expressions obscènes qui mettent en scène le corps ? Autant on peut suivre l’auteur sur l’importance prise par les objets qui environnent les combattants et qui font justement l’objet d’une dénomination imagée, autant sur la question du « corps », il est difficile de s’engager dans des interprétations uniquement tendues vers le même triptyque : « consentement », « brutalisation » et « culture de guerre ». Si Odile Roynette a conscience, et elle l’énonce à plusieurs reprises, des limites de la connaissance du contexte d’énonciation des mots relevés, de l’importance du groupe dans lequel se déploie le langage fleuri des combattants, son propos vise toujours et se ramène constamment à souligner le courage, le consentement des soldats dont elle étudie l’oralité. Il nous semble que cette étude aurait méritée de ne pas rester enclaver dans un système d’interprétation tellement rigide que l’auteur n’interprète ses sources que pour mieux le mettre en valeur, et non l’inverse. Ainsi, la notion de « culture de guerre » en particulier réapparaît quasiment en fin de chaque chapitre : chacun d’eux venant démontrer en fait son existence. L’emploi répété du terme « cathartique » ou « traumatisant » (la guerre est « d’emblée traumatisante » (p. 138)) révèle aussi de cette difficulté de penser la guerre autrement que dans le contexte de cette imprégnation structurante. Quelques répétitions[3] et figures de style aussi brouillent le propos. Ainsi, en évoquant le journal du jeune Yves Congar, témoin de l’occupation allemande : « Il est frappant de constater que le terme « poilu » par exemple, si chargé d’affects, n’est jamais utilisé par le diariste, qui, il est vrai, ne voit aucun soldat français jusqu’à la fin du conflit ». Est-ce alors réellement frappant ?
Nombre d’interprétations mériteraient beaucoup plus de nuances. Mais voilà, il faut encore montrer à tout prix l’aspect « totalisant » de la guerre, et lorsque Clemenceau mobilise le verbe et l’argot guerrier, c’est évidemment « à un niveau jamais atteint », sans que cela soit réellement démontré.
Au final, l’ouvrage d’Odile Roynette apparaît comme un exercice le plus souvent stimulant et met en lumière l’importance de la mobilisation des mots, des processus de construction de codes linguistiques que la guerre nationale, moderne et démocratisée, diffuse par différents canaux. Mais c’est bien du côté des présupposés que pêche la démonstration, qui auraient mérité de s’attarder sur la question des identités sociales pour mieux appréhender encore l’enjeu du « dire » combattant.
Lafon Alexandre – Université de Toulouse II – septembre 2011
Recensé:
Odile ROYNETTE, Les mots des tranchées, Paris, Armand Colin, 2010, 286 p.
[1] Odile Roynette prête à Antoine Prost l’expression « dire, c’est faire », pourtant présente dans la traduction française du livre du philosophe britannique John Langshaw Austin, Quand dire c’est faire, publié en anglais en 1962, How to do Things with Words – cité dans BOURDIEU Pierre, Ce que parler veut dire, Paris, Fayard, 1982, p. 103.
[2] Cru parle à propos de l’utilisation de l’argot par Barbusse de « l’artificiel qu’a un tel étalage ». Et de préciser : « En réalité, on parlait peu l’argot au front, les patois y tinrent une place beaucoup plus grande. En général, on parlait simplement français, un français mêlé d’un peu d’argot de caserne, d’argot colonial, adaptés et un peu augmentés pour les besoins de la guerre », dans CRU Jean Norton, Témoins, Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 2006, [1ère éd., Paris, Les Etincelles, 1929], p. 564.
[3] En particulier l’étymologie des mots « boche » ou « poilu ».

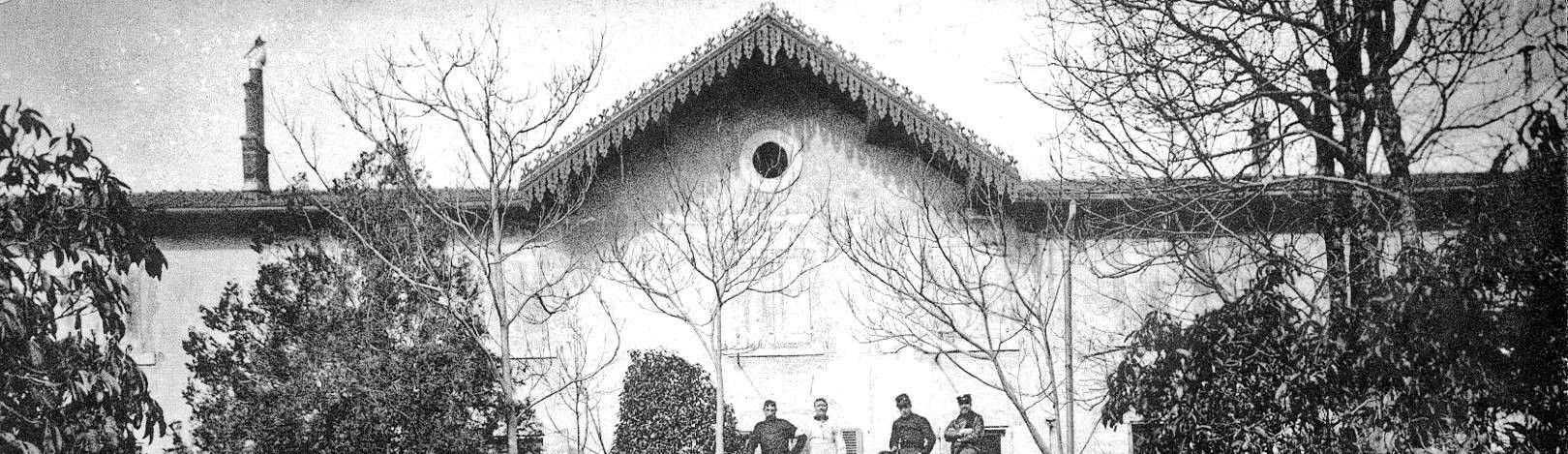
Les commentaires